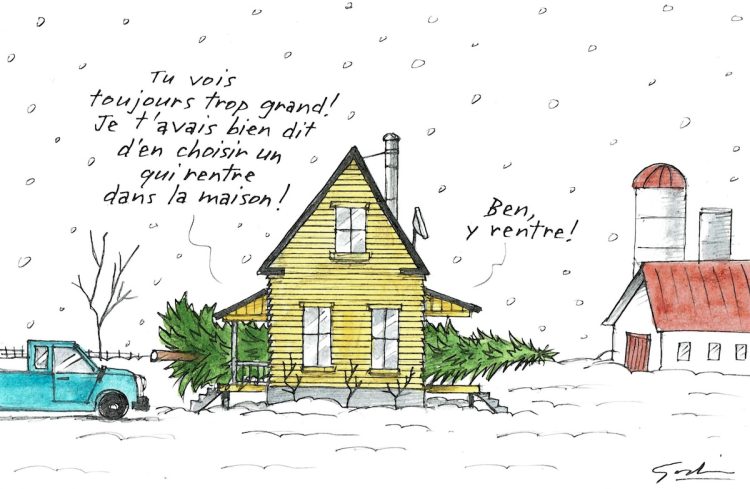La population de papillons monarques a fortement diminué dans les dernières années. De 500 millions il y a une dizaine d’années, l’espèce ne compterait plus que 30 millions d’individus dans les boisés du Mexique où elle hiverne. Cette diminution a été remarquée à l’est de Amérique du Nord où le papillon est beaucoup plus rare qu’autrefois.
Une partie du mystère aurait été levé selon ce que révèle une étude effectuée par des chercheurs à l’Université Guelph. Alors qu’on imputait la responsabilité à la disparition d’une partie de ses habitats au Mexique, il semblerait que la quasi disparition de l’asclépiade dans ses aires de reproduction au sud des États-Unis serait la principale cause de la diminution du nombre de papillons.
À lire aussi

Les résultats des essais maïs du RGCQ sont disponibles en ligne!
Les essais de maïs du Réseau grandes cultures du Québec (RGCQ) n’ont pas été à l’abri des problèmes connus par l’ensemble des producteurs cette année.
Quand elles atteignent le sud du Texas, les femelles pondent leurs œufs sur les feuilles d’asclépiades et meurent. Ce sont donc les adultes issus des métamorphoses de ces œufs en chenilles, puis en chrysalides qui prennent la route jusqu’au Québec. Dans nos régions, les adultes se reproduisent et deux ou trois générations peuvent s’y développer jusqu’en septembre. À ce moment, les derniers papillons entreprennent la migration vers le Mexique.
Mais comme les plants d’asclépiades se raréfient dans les champs grâce à l’efficacité des herbicides, il y a moins de monarques qui migrent. Les plants d’asclépiades auraient diminué de 21 % entre 1995 et 2013. Si l’asclépiade devient de moins en moins présente, l’étude prévoit une déclin de 14 % de la population actuelle de monarques dans l’est de l’Amérique du Nord au cours du prochain siècle.
Le papillon lui-même n’est pas considérée en danger car on la retrouve ailleurs en Amérique du Nord mais la migration telle qu’elle existe pourrait disparaître. La solution, selon les chercheurs, serait de planter des asclépiades dans les jardins et les bords de route.
Source: Le Devoir