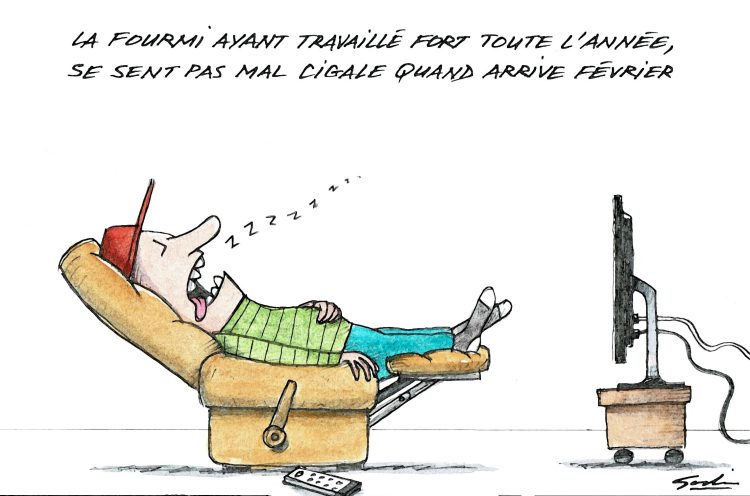Si le puceron est très actif cette année, il semble que le ver-gris occidental du haricot le soit également, mais auprès du maïs. Selon les données du Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP), les captures de papillons de ver-gris occidental du haricot ou VGOH, pour les intimes, ont fortement augmenté en 2022 dans la quasi-totalité des régions au Québec. À la fin du mois de juillet, la moyenne provinciale hebdomadaire se situait à son niveau le plus élevé depuis 2015 et suivait une tendance à la hausse notable depuis 2017.
À lire aussi

De nouveaux produits pour les érablières
Le secteur acéricole se développe à vitesse grand V. Voici un aperçu des nouveautés offertes par les fabricants et manufacturiers pour la prochaine saison des sucres.

Julien Saguez, biologiste-entomologiste et chercheur en biosurveillance au Centre de recherche sur les grains (CEROM), confirme. « Effectivement, on observe depuis quelques années une augmentation des populations de VGOH au Québec. On savait qu’une grande majorité des papillons provient généralement des papillons qui migrent depuis les États-Unis et l’Ontario. Mais nous avons récemment mis en évidence que le VGOH survit à l’hiver au Québec. Donc il est aussi possible que l’augmentation soit due au fait qu’on ait des populations locales qui émergent et contribuent à l’augmentation du nombre de papillons. »
Dans le cadre des observations du RAP Grandes cultures, des masses d’œufs ont été observées dans 12 champs des 38 champs dépistés. Le dépistage des masses d’œufs ou des jeunes larves est en effet l’élément à surveiller, et non la présence des papillons. Le seuil cumulatif d’intervention est de 5 % de plants infestés dans le maïs-grain ou ensilage. La méthode de dépistage est disponible dans cette vidéo. Les stades de la floraison et l’apparition des soies est un bon moment pour faire l’inspection puisqu’il peut attirer les papillons femelles pour la ponte.
Le moment d’intervention est toutefois très court, soit de cinq à sept jours. Il correspond à la période de maturation des œufs : s’ils sont de couleur blanche, ils ont été fraîchement pondus, alors que des œufs qui deviennent rosés, puis violacés se rapprochent de l’éclosion. Des œufs gris foncés ou noirs sont potentiellement parasités par des trichogrammes. « Une intervention ne devrait pas être effectuée si le seuil d’intervention n’est pas atteint. La décision d’intervenir doit être prise en consultant son agronome. En général, on tient compte également de la présence d’ennemis naturels. Par ailleurs, si un producteur utilise un hybride Bt Viptera, le recours à un insecticide ne serait pas justifié, car cette technologie protège la culture contre le VGOH », indique M. Saguez.
Un ravageur à surveiller
Depuis les premières observations du VGOH au Québec en 2009, les populations sont en constante hausse dans la province. La bonne nouvelle est que « les populations les plus élevées se retrouvent presque toujours dans les mêmes secteurs et qu’elles ne varient pas beaucoup d’une année à l’autre », mentionne le RAP. Un champ infecté risque de l’être de nouveau si des mesures ne sont pas prises contre le ravageur.
En plus des grains mangés et de la perte de rendement, le risque principal lié au VGOH est la perte de qualité. « L’une des conséquences secondaires de la présence de larves dans les épis est qu’elles peuvent favoriser la présence et la prolifération de champignons pathogènes, comme la fusariose, et par conséquent augmenter les risques de contamination avec des mycotoxines », soulève M. Saguez.
Le bio-entomologiste ajoute que le VGOH fait l’objet d’une étude pour évaluer son impact dans les cultures de maïs au Québec. « Cet automne, nous allons récolter des épis de maïs dans les champs qui présentent différents taux d’infestation. L’objectif est de déterminer le nombre d’épis endommagés et de voir s’il est possible de corréler ce nombre avec le pourcentage de plants infestés pendant la saison par des masses d’œufs et des jeunes larves. » Des analyses de mycotoxines sur des épis au moment de la récoltes sur des épis sains et infestés seront également réalisées pour déterminer les risques associés au VGOH.
Les facteurs de risques à considérer
Pour l’instant, certains facteurs de risques ont été mis en évidence dans le cas du VGOH par le RAP:
1. Les champs sableux ou situés dans une zone de sols sableux (facteur de risque le plus élevé).
2. Les champs situés dans un secteur avec des superficies importantes de haricots.
Au Québec, ces deux facteurs s’appliquent uniquement dans les régions climatiques où l’émergence des adultes peut survenir en même temps que la floraison du maïs (Montérégie, sud de l’Outaouais, Laurentides, Lanaudière et Centre-du-Québec).
Certaines pratiques culturales peuvent aussi augmenter le niveau de risque :
1. Semis tardifs ou retardés à cause d’un mauvais drainage ou de pluies trop fréquentes.
2. Monoculture de maïs non dotée de la technologie Vip3A.
3. Enfin, les champs avec des conditions de croissance inégales qui retardent la floraison d’une partie des plants sont plus à risque d’être choisis par les femelles pour la ponte des œufs.
M. Saguez recommande une évaluation des dommages aux épis avant la récolte en cas d’infestation pour savoir si un hybride adapté serait nécessaire l’an prochain. En fonction des résultats, le producteur pourra prendre une décision éclairée avec son agronome. « Les hybrides Bt Viptera sont la seule technologie Bt qui ciblent le VGOH actuellement. Toutefois, cette technologie ne repose que sur un seul gène Bt. C’est l’une des solutions qui peut être envisagée pour lutter contre le VGOH, mais pas la seule. En effet, on peut avoir recours à d’autres méthodes, comme les trichogrammes (nous avons un projet en cours sur ce sujet), mais aussi les insecticides. Il faut toutefois être prudent en utilisant les différentes méthodes de lutte afin d’éviter le développement de résistance étant donné qu’il n’y a qu’un gène qui protège contre le VGOH actuellement. »
Le choix de la méthode de lutte devrait d’ailleurs être fait en concertation avec un agronome, souligne le bio-entomologiste.
Pour un complément d’information, une fiche sur le VGOH rédigé par le RAP est disponible.