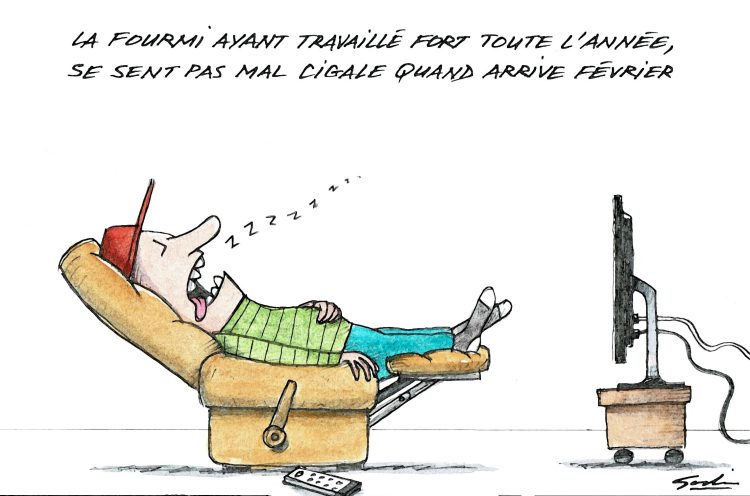La place des agronomes a changé au fil du temps. De nos jours, ils doivent prendre plus de place auprès du public afin de rapprocher la science des consommateurs. Car, il faut bien le dire, les défis du secteur agricole sont nombreux et le futur apporte son lot de questionnements. Et cela passe par une modernisation de la Loi sur les agronomes.
Le Congrès de l’Ordre des agronomes a eu lieu les 23 et 24 septembre 2021 sous le thème « Agronomes et Société : Partenaires de changement ».
La plus grande crise que l’Ordre des agronomes a dû vivre dans les récentes décennies a certainement été celle portant sur l’utilisation des pesticides. Elle a mené le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ), André Lamontagne, à présenter son Plan d’agriculture durable en octobre 2020. Le ministre s’est d’ailleurs adressé aux agronomes en début de congrès pour leur rappeler qu’ils ont un rôle essentiel à jouer dans la mise en œuvre de ce plan d’une durée de 10 ans. Le ministre Lamontagne a aussi dit qu’il suit de près les travaux de modernisation de la Loi sur les agronomes.
À lire aussi

Agenda des événements agricoles
Colloque sur les plantes fourragères, Sommet sur l’eau, Journée ovine, Webinaires sur l’agrométéorologie, il y en a pour tous les goûts cette semaine. Tous les détails dans votre agenda des évènements agricoles.
Sur ce sujet, la nouvelle présidente de l’Ordre des agronomes, Martine Giguère, a annoncé en ouverture du congrès que le conseil d’administration avait accepté que l’Ordre oriente ses travaux afin de séparer la vente des services-conseils. Cette décision s’appliquera non seulement au secteur de la phytoprotection, mais aussi à tous les autres champs de pratique des agronomes. L’Ordre veut éviter de faire des sous-groupes ou sous-classes d’agronomes.
En entrevue, Martine Giguère explique que cette décision fait partie de la mise en œuvre des recommandations du comité d’indépendance professionnelle. Plusieurs de ces recommandations ont été mises en place, dont la déclaration de conflit d’intérêt. À partir du premier avril 2022, les factures remises aux clients devront inclure séparément les honoraires de l’agronome et la vente de produits. « On veut éviter toute apparence de conflit d’intérêt », dit Mme Giguère. L’agronome pourra ainsi œuvrer « en toute transparence ».
Partenaires de changement
Le congrès de cette année portait justement sur les enjeux de société. Dans sa conférence portant sur la réflexion et le dialogue éthique, la professeure Allisson Marchildon, spécialisée en éthique à l’Université de Sherbrooke, a expliqué que les travaux de modernisation du métier d’agronome, auxquels elle a participé, sont essentiels. Selon elle, la discussion autour de la profession d’agronomes dans les médias et la sphère publiques est une belle opportunité. « C’est une occasion à ne pas manquer », dit-elle. C’est important pour maintenir le lien de confiance avec la population.
D’ailleurs, la nutritionniste Hélène Laurendeau s’est servie de son expérience comme vulgarisatrice pour inciter les agronomes à prendre davantage la place qui leur revient comme communicateurs de la science agronomique auprès de la population.
Le professeur Julien Prud’homme de l’Université du Québec à Trois-Rivière est un spécialiste de l’histoire des ordres professionnel. Il raconte que l’Ordre des agronomes a vécu trois grandes périodes dans le débat public. Dès 1920, l’agronome devient un personnage important. Cette période a mené, en 1937, à la création de la Corporation des agronomes du Québec. Le Québec a même eu un premier ministre agronome, Adélard Godbout, de 1939 à 1944. À partir du Code des professions, en 1973, les agronomes sont davantage effacés du débat parlementaire et public. Toutefois, les dernières années ont remis l’importance de l’agriculture et le métier d’agronome à l’avant-plan.
L’agronome et journaliste Nicolas Mesly a présenté cinq enjeux qui lui tiennent à cœur et pour lesquels il a investigué. Selon lui, l’agronome a un rôle clé face à l’urgence climatique. L’agriculture fait partie de la solution et pour cela, il faut un sol en santé. L’eau est une autre préoccupation. À l’heure où l’eau va redéfinir le commerce mondial, qu’adviendra-t-il de l’or bleu du Québec? Il faut de l’eau pour faire de l’agriculture. La viande et le lait de laboratoire sont deux secteurs sur lesquels de grands joueurs investissent massivement. De quoi sera fait l’alimentation de demain? Donald Trump a eu un gros impact sur le commerce agricole au Canada. Sera-t-il de retour en 2024? Le cinquième enjeu de Nicolas Mesly fera partie d’un documentaire qui sera présenté le 16 octobre à l’émission Doc Humanité à Radio-Canada : Québec, terre d’asphalte. On y parlera, bien sûr, de l’étalement urbain.
Un autre enjeu de l’agriculture est l’accessibilité de l’alimentation pour tous. Deux conférencières abordaient cet enjeu : Dr. Chantal Line Carpentier, cheffe de bureau du Secrétaire général de la Conférence des Nations Unis sur le commerce et le développement, et Geneviève Parent, professeure titulaire de la Chaire de recherche en droit sur la diversité et la sécurité alimentaire de l’Université Laval. Alors que la faim dans le monde régressait, elle a recommencé à croître. La pandémie de COVID-19 a augmenté les inégalités autant du côté de l’accès aux vaccins que du côté de la malnutrition.