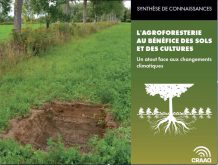Qu’obtenez-vous si vous mélangez un écosystème fragile, plusieurs acteurs économiques qui dépendent de ce milieu de vie et de multiples paliers gouvernementaux? Vous avez un problème complexe qui mène souvent à des solutions rigides et étroites, au malheur de la plupart des personnes concernées. C’est ainsi qu’on pourrait résumer la situation au lac Saint-Pierre qui a reçu par l’UNESCO en 2000 le statut de Réserve mondiale de la Biosphère, en raison de la richesse de sa biodiversité.
Depuis 2012, un moratoire sur la perchaude tente de sauver l’espèce qui a vu sa population réduire de manière importante devant la détérioration de son habitat. Les solutions ont toutefois apporté peu d’améliorations et ont mené à une dégradation des relations entre les parties concernées et les gouvernements. En particulier, les producteurs agricoles ont vu dans certains cas leurs terres leur être retirées à des fins de conservation, mais louées par la suite pour y faire de la culture.
La situation a interpellé Ann Lévesque, nouvellement détentrice d’un doctorat en sciences humaines et sociales de l’environnement à l’Université du Québec en Outaouais (UQO). Elle a bien voulu résumer les grandes lignes de sa thèse de doctorat qui croise politiques environnementales et sociologie.
À lire aussi

L’UPA demande plus de transparence pour le projet de TGV
Des agriculteurs et des citoyens affectés par le tracé préliminaire du projet de TGV reliant Québec et Toronto ont manifesté le 24 février à Mirabel. Ils réclament plus de transparence dans ce dossier.
« Aujourd’hui, les défis environnementaux sont complexes et nécessitent à la fois l’expertise scientifique et l’intégration de diverses connaissances pour raffiner notre compréhension du problème et réfléchir collectivement sur les stratégies possibles pour les aborder. Dans le cas du lac Saint-Pierre, les acteurs du milieu ont des points de vue divers sur les actions à adopter pour restaurer l’habitat de la perchaude. Cela inclut le choix des cultures à privilégier, le soutien financier et humain requis, les processus décisionnels et les moyens de maintenir les efforts de restauration à long terme. »
Les résultats de sa recherche soulignent l’importance de considérer les incertitudes et les inégalités quant aux gestes posés dans ce type de situation afin de favoriser une bonne cohabitation, quitte à prendre des décisions tout en admettant que certaines questions restent sans réponse, ce qui est à l’opposé de ce à quoi on assiste en matière de politiques environnementales.
« Il est essentiel d’analyser les contraintes et répercussions que la conservation exerce sur les terres agricoles avoisinantes. Dans le cas du lac Saint-Pierre, ces mesures entraînent des inquiétudes parmi les producteurs agricoles, telles que de la détresse économique et la pression pour délocaliser leur production. Dans certains cas, la conservation peut même amplifier une intensification des activités agricoles pour compenser la perte de terres liée à la conservation ou en réaction à une augmentation de la valeur foncière due à leur rareté », indique Ann Lévesque.
L’enjeu est important puisqu’on se retrouve devant une nouvelle réalité de changements globaux, explique Jérôme Dupras, directeur de la Chaire de recherche du Canada en économie écologique, et superviseur de la thèse de Mme Lévesque. On assiste à l’éclosion de situations de plus en plus complexes qui vont demander des solutions à appliquer rapidement en raison de l’urgence. « Les faits, ou la science, ne sont pas remis en question, mais ce ne sont pas les seuls arguments à considérer. Il y a aussi les sciences sociales, les sciences économiques qui sont plus incertaines, mais dont on doit tenir compte de la part des politiques, ce qui est plus difficile pour les décideurs. »
Ann Lévesque a pris en compte les procédures de prise de décision et a mis en évidence les inégalités dans le cas du lac St-Pierre où certaines voix semblent avoir porté plus que d’autres durant le processus de prise de décision.
Il en est ressorti un fort sentiment d’injustice de la part des agriculteurs et un manque de reconnaissance quant à certaines pratiques ancestrales.
Alors qu’agriculture et conservation sont souvent en opposition et polarisent, il faut favoriser plus de débats, de discussion et de transparence pour avoir des chances de réussite dans la mise en place de politiques environnementales conclut M.Dupras.