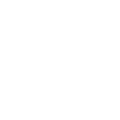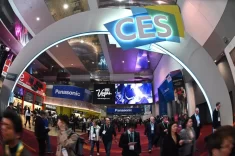Le congrès du Réseau québécois de la recherche en agriculture durable (RQRAD), qui avait lieu du 11 au 13 février à Québec, a été une occasion en or de se plonger au cœur même des travaux effectués en ce moment au Québec dans le domaine agricole, selon les quatre axes poursuivis par le RQRAD. Ces derniers sont les solutions de rechange aux pesticides de synthèse, la conservation et restauration de la santé des sols agricoles, les outils numériques, l’agriculture de précision et les données massives, ainsi que les aspects socioéconomiques touchant l’adoption, les systèmes d’innovation et la politique publique.
Durant les trois jours, des chercheurs provenant de différentes institutions ont partagé les résultats de travaux en cours, dont plusieurs étudiants en maîtrise et doctorat. Voici un bref aperçu de ce qui a été présenté durant le congrès.
Plusieurs recherches ont mis à profit les banques de données disponibles en agriculture pour mieux comprendre des interactions entre sol, environnement, ou encore le traitement d’images, pour effectuer de meilleurs diagnostics.
À lire aussi

Expo-Champs 2025 : sous le signe de l’action
Dans moins d’un mois s’ouvrira l’édition 2025 d’Expo-Champs à Saint-Liboire. Voici à quoi doivent s’attendre les visiteurs cette année.
Les drones sont dans ce sens de plus en plus utilisés pour capter et analyser des images. Une application est en développement à l’Université McGill et à l’Association canadienne pour les plantes fourragères (ACPF) pour déterminer la survie des luzernières à l’aide de photos prises dans le champ. Un groupe a pu élaborer un modèle prédictif efficace à plus de 95%, en prenant une multitude de photos et en les faisant analyser grâce à l’intelligence artificielle.
L’érosion dans les sols organiques a été le sujet d’une étude regroupant plusieurs universités dans des terres de la Montérégie-Ouest en été 2022. Le déplacement de particules a causé des pertes de 34 T/ha, ou 14 T/ha lorsqu’on retire les valeurs maximales pouvant être attribuées à la minéralisation ou à l’érosion hydrique. Les pertes ont davantage été causées par les vents latéraux que ceux en hauteur, mais il faudra pousser davantage la recherche puisque les pertes de terres ne seraient pas liées aux particules fines.
Quel est le meilleur moyen de drainer des terres compactées? Une étude comparative de l’Université Laval entre l’utilisation de saules sur deux ans et des tranchées drainantes ont démontré des résultats plus probants et à plus long terme avec les saules. Une fois détruit, l’effet des saules a perduré encore trois ans dans les terres où la technique avait été utilisée.
Louis Longchamps, de l’Université Cornell, a présenté un modèle développé afin d’intégrer les expérimentations que font d’eux-mêmes les producteurs agricoles afin d’en déduire les résultats et les faire partager aux autres producteurs. Il procède actuellement à ce genre d’approche dans l’État de New-York, appelée On-Farm Experimentation. Le modèle offrirait plus de chance de réussite à long terme puisqu’il s’élabore à partir des initiatives des producteurs eux-mêmes.
Lucie Violland, étudiante à la maîtrise à l’UQAM, a analysé la manière dont John Deere utilisait depuis plus d’une décennie les données recueillies par ses différentes applications pour développer des services vendus aux producteurs agricoles. Bien que les producteurs puissent toujours utiliser à titre personnel les données qu’ils fournissent, il existe des limites qui pourraient limiter leur usages. On peut aussi s’interroger sur le fait que John Deere soit dépositaire d’autant de données sur les terres en Amérique du Nord et la manière dont il les monétise.
Sur l’aspect socio-économique, des travaux ont démontré que l’aspect social était déterminant dans l’adoption de pratiques agricoles durables. Les gouvernements doivent d’abord se préoccuper des réalités sur le terrain avant d’élaborer leurs politiques. Elles doivent également bénéficier d’un accompagnement pour s’assurer d’être un succès.
Paul Thomassin, de l’Université McGill, a fait valoir que les institutions devaient s’adapter aux changements climatiques et aux pressions financières des producteurs agricoles, dont la rentabilité est minée depuis plusieurs années. Une réforme de La Financière agricole est dans ce sens nécessaire.
Geneviève Grossenbacher, directrice des politiques à Fermiers pour la transition politique, en vient au même constat à la suite d’un sondage mené auprès des producteurs agricoles sur les changements climatiques. C’est au Québec que la menace que posent les changements climatiques est considérée comme étant le principal défi actuellement en agriculture. L’étude démontre que 76% des producteurs interrogés avaient été affectés directement par un événement climatique majeur. Dans ce sens, le mécanisme de réponse des organismes assurant une forme de protection est jugé désuet puisqu’ils doivent constamment s’ajuster et réagir après coup.
Il ne s’agit que d’un aperçu de ce qui a été présenté au cours du congrès. Toutes les présentations (plus de 50) et le résumé des recherches sont disponible sur le site du RQRAD.
À lire aussi:
Le grand rendez-vous des chercheurs en agriculture durable s’amène à Québec