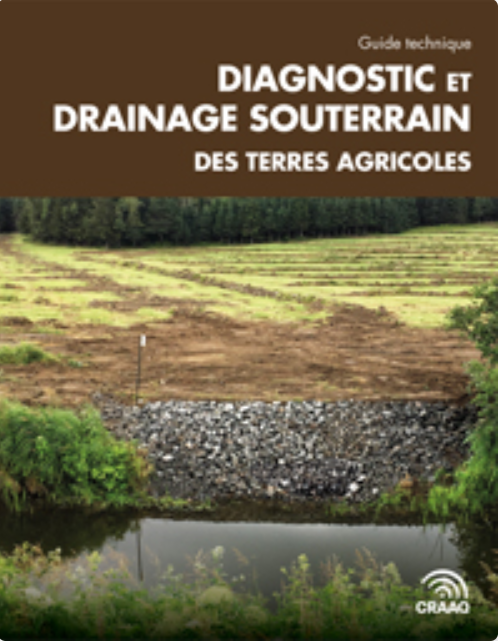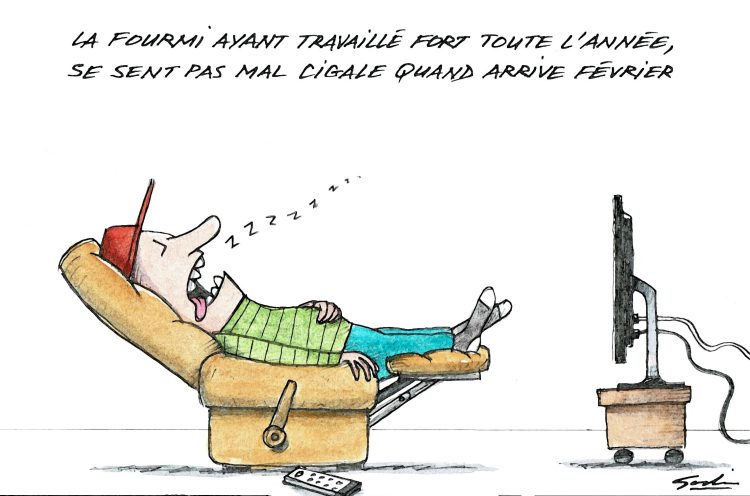Plusieurs problèmes apparents d’excès d’eau au champ peuvent avoir des causes bien différentes. Le drainage souterrain n’est pas toujours la solution. Avant de décider d’un chantier, l’essentiel est donc de bien diagnostiquer.
Comment faire un état des lieux détaillé?
À lire aussi

Améliorer la détection des maladies des vaches laitières grâce à l’IA?
Selon des chercheurs, avec l’aide de l’intelligence artificielle, il serait possible de détecter des maladies chez la vache laitière.
L’établissement du diagnostic demande une grande attention aux détails. Plusieurs sources d’information seront donc nécessaires. La carte d’élévation permettra d’analyser finement la topographie (baissières, changements de pente, zones de nivellement irrégulier). La carte des rendements aidera à situer les zones à plus faible rendement ou à problèmes (végétation basse ou jaunissante, compaction, par exemple), et à se poser des questions. Les problèmes sont-ils localisés ou étendus? Sur quels types de sols ou de pentes se présentent-ils? L’inventaire des facteurs influençant la circulation d’eau dans le sol doit aussi considérer la rotation, le poids à l’essieu de la machinerie, les dates d’entrée au champ et la matière organique du sol.
Les observations au champ ajoutent des précisions indispensables : inspection du fonctionnement des fossés; délimitation des zones restant inondées après les fortes pluies (localisation, durée), des zones compactées ou érodées, d’écoulements provenant de parcelles voisines, etc. De plus, si on observe du sol à nu instable, sans infiltration, cela veut dire qu’il y a perte d’eau par ruissellement et souvent érosion. Cet état des lieux doit se faire pendant les périodes humides de l’année, le printemps ou l’automne. Sinon, on risque de manquer des éléments d’information essentiels!
La lecture des profils de sol
Des profils de sols seront creusés à quelques endroits stratégiques, à des profondeurs de 60 à 90 cm, voire jusqu’à 1,5 m. Ils fourniront les signes de présence et de mouvement de l’eau et une foule d’informations cruciales. On y observe la coloration selon les horizons. Par exemple, un brun plus ou moins pâle correspond à du fer oxydé, donc à une certaine aération du sol; des zones d’un gris bleuté montrent une absence d’oxygène et probablement une saturation en eau. L’odeur soufrée est un indice de résidus végétaux en décomposition dans un manque d’oxygène. Certains constats sur l’état et la profondeur des racines vont révéler de la compaction : par exemple, moins de racines, racines bifurquant vers les côtés.
Rafraîchir le réseau hydraulique
Le réseau hydraulique peut montrer des signes de déficience par endroits. Cela peut être dû à des fossés en mauvais état, des rigoles d’interception non fonctionnelles, ou à un avaloir inefficace, sous-dimensionné ou mal positionné. Dans ces cas, l’eau stagnera et sera mal évacuée. On peut aussi remarquer que l’eau des parcelles et boisés du voisin s’écoule sur notre champ. Des travaux de correction spécifiques à ces situations sont donc requis en premier lieu.
Bien interpréter les mouvements de l’eau
On peut remarquer dans un profil de sol que l’eau reste proche de la surface et ne s’infiltre pas. Plusieurs signes se présentent : odeur d’œuf pourri, signe de manque d’oxygène, des racines ne descendant pas, une zone qui n’arrive pas à ressuyer. Ils montrent la présence d’une semelle de labour : l’eau est bloquée au-dessus de cette zone compactée, c’est un cas de nappe perchée.
Le trou pédologique creusé à une bonne profondeur montre-t-il un suintement le long des parois à différentes hauteurs? C’est un écoulement hypodermique. Il pourrait être confondu avec une nappe perchée. Pour le distinguer, on recherchera son fonctionnement particulier sur le terrain : l’eau ne peut pas descendre pour continuer son chemin, donc elle suit la couche imperméable jusqu’à trouver un point de sortie. Il sera repérable plus loin le long d’une pente, dans un creux, etc.
Dans le cas où on a une véritable nappe phréatique élevée, de l’eau est visible au fond du trou et elle remonte du sous-sol (photo ci-dessous). C’est dans ce type de cas seulement qu’un plan de drainage souterrain pourrait être requis.

Les autres situations demandent des solutions différentes. Un sous-solage peut remédier à une nappe perchée, à condition de l’accompagner de cultures de couverture et d’autres moyens selon les causes de la compaction. Il s’agit du nivellement, de l’installation d’un avaloir pour vider une cuvette, etc. Pour un écoulement hypodermique, les aménagements pourront être des voies d’eau engazonnées, une rigole d’interception avec ou sans puits filtrant ou une tranchée filtrante.
En conclusion : penser à long terme
L’amélioration du ressuyage des champs, de la circulation et de la rétention de l’eau peut donc passer par plusieurs interventions. Cela vaut la peine d’y penser dans la globalité. Omettre certains signes ou certaines causes peut amener à effectuer des travaux coûteux et inadaptés. De plus, les efforts pour régénérer la santé du sol sont nécessaires et payants. Diminuer le poids à l’essieu pour éviter la compaction; diversifier la rotation; ajouter des cultures de couverture à enracinement profond qui augmentent la matière organique : autant de gestes qui aideront à une bonne gestion de l’eau du sol à long terme.
Vos ressources : Guide Diagnostic et drainage souterrain des terres agricoles (www.craaq.qc.ca) et la série de webinaires en santé des sols, sur Agri-Réseau.
*Cet article est issu d’une collaboration entre le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ) et Le Bulletin des agriculteurs.
Pour lire d’autres articles du CRAAQ: AGRInnovant et bonnes pratiques.