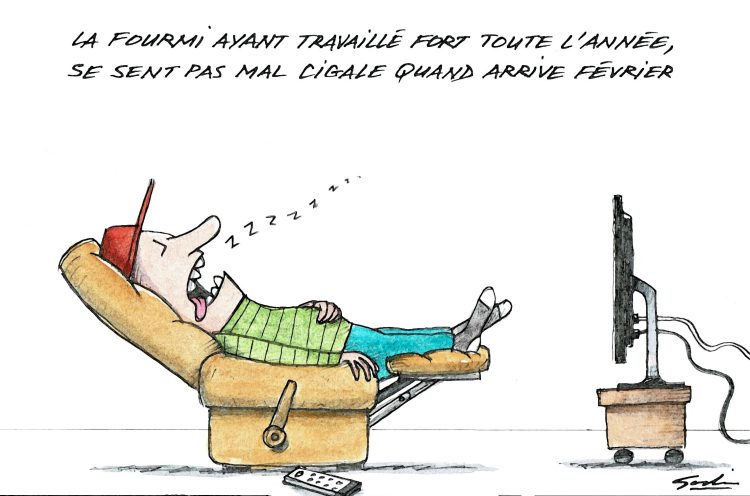La résilience des sols est certainement un des sujets de l’heure, alors que ces derniers sont soumis à des épisodes de sécheresse ou encore à des excès d’eau, comme ce fut le cas l’an dernier dans plusieurs régions.
Le MAPAQ a eu l’idée de réunir dans un webinaire deux expertes dans des domaines différents, mais qui poursuivent les mêmes buts, soit améliorer la capacité des sols à faire face à des événements de plus en plus extrêmes.
Laura Van Eerd, du campus de Ridgetown de l’Université de Guelph, en Ontario, avait à partager des données collectées sur 65 ans de recherche sur la rotation des cultures. Les essais sont menés sur deux sites de recherche, à Elora et à Ridgetown. Sans surprise, les études démontrent un effet de la rotation des cultures sur l’amélioration des rendements. En utilisant du blé d’automne en rotation, les hausses de rendement sont de l’ordre de 7% pour le maïs et de 12% pour le soya. Laura Van Eerd a cependant ajouté que des améliorations avaient été notées en utilisant de l’avoine et de l’orge, avec un supplément en trèfle rouge.
À lire aussi

Des céréales secouées par le dollar américain
Les turbulences économiques et politiques aux États-Unis ont fait grimper les céréales avec le blé comme gagnant de la semaine.
La chercheuse a mentionné que loin de s’estomper, l’effet des rotation affecte les résultats à long terme en améliorant le rendement, la santé des sols, la résilience et également par une demande moins élevée d’azote.
L’étude s’est penchée sur le rendement uniquement durant les années sèches et là encore, on note une différence positive du rendement de 2,5% grâce à la rotation. Les sols sains, avec plus de matière organique, ont démontré plus de résilience. Ils se trouvent davantage protégés et permettent une plus grande marge d’erreur.
Des études ont également été menées sur l’apport des cultures de couverture. En gros, elles démontrent que les cultures de couverture apportent de la matière organique et que les cultures implantées réagissent en donnant plus de rendement. Elles ont aussi eu moins besoin d’apports en azote. Une étude de coûts permet de voir que la première année d’implantation de cultures de couverture se traduit par des coûts, mais que la rentabilité augmente à la troisième année et continue par la suite. Dans une méta analyse de 87 études sur les céréales, une augmentation de rendement de 12 à 25% de rendement a été observé dans un système de céréales et maïs.

Gestion de l’eau
La gestion de l’eau est un sujet brûlant ces dernières années, autant par l’absence de l’eau dans les moments charnières des cultures que par les effets nuisibles quand l’eau peine à s’évacuer des champs. « Le défi dans les prochaines années sera de s’assurer de donner à la plante ce dont elle a besoin au bon moment, au bon endroit, en bonne quantité », a déclaré en début de présentation Hélène Bernard, ingénieure au MAPAQ. Il faut, a-t-elle indiqué, apporter des solutions adaptées au climat actuel en posant le bon diagnostic devant un problème observé dans le champ.
Pour y arriver, il faut à la fois poser un regard sur l’environnement du champ et sur le sol lui-même. Le premier signifie étudier le réseau hydraulique (vers où s’écoule l’eau), le drainage de surface et le drainage souterrain. L’étude de la structure de sol va quant à elle relever la texture, la structure, la couleur et l’odeur du sol. La profondeur recommandée dans ce cas est d’au moins 4 pieds et peut se faire en tout temps, à moins de vouloir observer un problème particulier, comme la nappe phréatique. « C’est important de comprendre ce qui se passe pour pouvoir intervenir de manière réaliste, avant de commercer à faire des travaux », souligne Hélène Bernard.

Au sujet des différents travaux, une attention particulière doit être apportée aux ponceaux. À partir d’un diamètre de plus de 1,2 mètre, ils doivent faire l’objet d’un devis fait par un ingénieur afin de tenir compte du débit d’eau et de l’écoulement en amont ou en aval. De nombreux autres éléments doivent être considérés, comme l’explique cette diapo présentée lors du webinaire:

D’autres ouvrages peuvent donner un coup de main à l’écoulement dans certains champs, comme de nouveaux fossés, des avaloirs ou du sous-solage. Quant au doublage des drains, l’experte n’est pas contre. Elle recommande d’investiguer pour connaitre la cause du problème: il peut s’agir de drains bouchés, brisés, mal conçus, ou qui ne conviennent face à des techniques plus avancées de drainage.
Et si elle avait à recommander un premier travail à faire en gestion de l’eau, l’ingénieure recommanderait d’isoler hydrauliquement le champ par un fossé (par exemple dans le cas d’un boisé adjacent) pour passer à du drainage de surface et terminer avec le drainage souterrain.
Il ne faut pas se fier uniquement à la capacité du sol à gérer toute l’eau de surface par infiltration, un problème qui aura tendance à s’accentuer, dit l’ingénieure. Mais dans les solutions à apporter, il faut aussi tenir compte de sa capacité à assumer les dépenses et les bénéfices (rentabilité accrue) que l’entreprise en tirera.
Le webinaire sera disponible sur les réseaux sociaux dans les prochaines semaines.