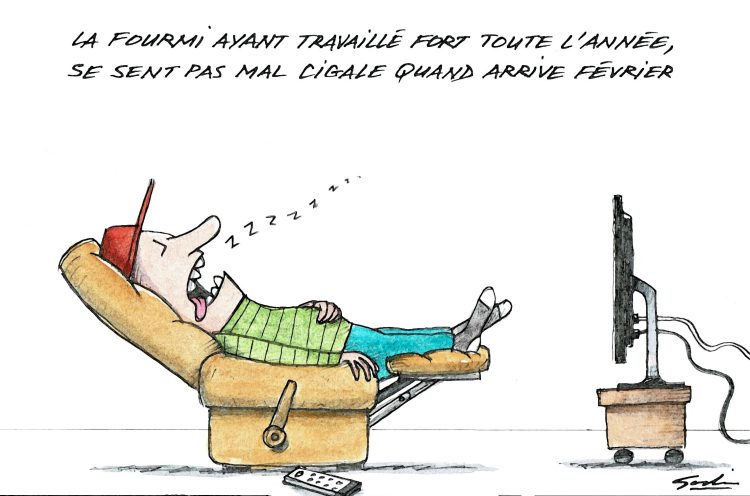Je vous propose de passer en revue la question de la maturité physiologique du maïs, d’une part, parce que les semis de maïs se sont étendus jusqu’en juin, d’autre part, parce que depuis 2019, il y a eu peu de pression pour sélectionner des hybrides à maturité physiologique précoce.
On le sait : dans un groupe d’hybrides auxquels on attribue la même cote d’unités thermiques maïs (UTM), certains atteignent la maturité physiologique plus rapidement que d’autres. En effet, la cote UTM est principalement calculée à partir de la teneur en eau à la récolte, sans accorder beaucoup d’importance aux stades de développement antérieurs observés en cours de saison. Or, les hybrides qui atteignent précocement la maturité physiologique protègent mieux leur rendement lors des saisons froides. En revanche, durant les années chaudes, ils risquent de produire un rendement moindre, faute d’avoir utilisé pleinement toute la saison de croissance.
C’est pourquoi autant les sélectionneurs que les agriculteurs tendent, souvent malgré eux, à choisir des hybrides à maturité physiologique plus tardive lorsque les UTM sont en surplus. Ces hybrides, qui paraissent tardifs en septembre, peuvent se rattraper en octobre grâce à leur capacité de séchage rapide, terminant la saison avec une teneur en eau similaire à celle d’hybrides ayant atteint plus tôt la maturité physiologique. Cependant, lors des saisons déficitaires en UTM, c’est l’inverse qui se produit : une maturité physiologique tardive peut entraîner des pertes de rendement, une baisse de la qualité du grain et une fragilisation des tiges.
À lire aussi

Bonne semaine à Chicago
La demande venant de l’étranger a soutenu les prix dans les derniers jours.
Environ 60 jours après la fécondation des ovules, le maïs atteint sa maturité physiologique. À ce stade, la partie laiteuse du grain a disparu et un point noir apparaît à sa base. Le grain a alors accumulé le maximum de matière sèche possible et contient environ 35 % d’eau, dont une partie s’évaporera par séchage naturel avant la récolte. Les hybrides plus « conservateurs » atteignent plus rapidement la maturité physiologique, mais sèchent plus lentement que les hybrides plus « risqués ». Ces derniers continuent d’accumuler du rendement pendant quelques jours supplémentaires, avant de connaître une phase accélérée de dessiccation. Pour ces hybrides, le rendement espéré dépend fortement des conditions climatiques en fin de saison.
Observer la ligne d’amidon du maïs
Les producteurs de maïs fourrager ont l’habitude d’observer la ligne d’amidon (un stade qui précède la maturité physiologique) parce qu’elle constitue un bon indicateur visuel de la teneur en eau du grain et, dans une moindre mesure, de celle de la plante. Pour les producteurs de maïs-grain, l’observation de la ligne d’amidon sert surtout à comparer le stade phénologique des hybrides, ce qui aide à orienter les choix de semences pour la saison suivante.
Pour évaluer précisément la position de la ligne d’amidon, on examine quelques grains provenant de trois ou quatre épis représentatifs, puis on fait la moyenne des observations. On trace alors une ligne imaginaire reliant les extrémités du grain et on exprime, en pourcentage de cette longueur, la position de la démarcation entre la partie dure et la partie laiteuse (voir ligne bleue, photo 1). Il est recommandé de toujours casser les épis au même endroit (au centre) afin d’assurer la constance de l’évaluation. La ligne de démarcation est plus facile à observer lorsqu’on coupe les grains, comme le montre la photo.
Cet exercice prend tout son sens lorsqu’on compare plusieurs hybrides soumis à la même régie, c’est-à-dire dans une même parcelle d’essai. On estime qu’un point de pourcentage de progression de la ligne d’amidon correspond à environ 5 UTM. Ainsi, si deux hybrides affichent des lectures de 20 et 40 %, celui dont la ligne est à 40 % accusant un retard d’environ 100 UTM sur l’autre par rapport à la maturité physiologique. Comme mentionné plus haut, cet écart ne se traduit pas nécessairement par une différence de teneur en eau à la récolte. D’où la nécessité d’observer la ligne d’amidon en septembre.
Pour lire d’autres blogues de Jean-Marc Montpetit, cliquez ici.