Des innovateurs en horticulture, boursiers du Défi Cultiver l’innovation d’ici, se sont réunis le 5 décembre à Toronto à l’occasion d’un forum de partage sur leurs projets de recherche. L’hôte de la rencontre, la Fondation de la famille Weston, a lancé le Défi en 2022 pour encourager les entrepreneurs et les chercheurs de partout au pays à former des équipes pour accélérer l’innovation autour d’enjeux pressants, comme celui de la sécurité alimentaire. Ce forum fut à l’image du Défi : une mise en commun pour avancer plus vite, plus loin.
«La particularité du Défi — ce qu’on n’a pas vu beaucoup ailleurs comme chercheurs universitaires — c’est qu’il encourage la collaboration entre les équipes, et comporte une composante de mentorat», explique Martine Dorais de l’Université Laval — une des récipiendaires présente le 5 décembre. Elle fait équipe avec l’entreprise innovante CycloFields de Granby sur le projet VertBerry — un système de culture verticale intérieure et aéroponique qui vise à réduire les besoins en main-d’œuvre tout en évitant l’utilisation de pesticides.
 L’équipe VertBerry de l’Université Laval et Cyclofields
L’équipe VertBerry de l’Université Laval et CyclofieldsÀ lire aussi

Obtenez le meilleur de votre troupeau laitier
Temps et profit Seulement deux petits mots, mais c’est sur eux que les producteurs laitiers fondent la plupart de leurs…
En plus d’appuyer des projets innovants comme VertBerry, ce Défi contribuera à la formation d’un doctorant. «Le secteur agricole a grand besoin d’une relève hautement qualifiée», explique Steeve Pepin de l’Université Laval et codemandeur du projet.
Éric Deschambault et son fils Antoine ont lancé CycloFields il y a près de 4 ans pour développer des systèmes aéroponiques. Bien que l’aéroponie permet des gains significatifs de croissance et de réduction des ressources, elle n’est pas sans risques : les racines des plantes sont exposées à l’air, les rendant vulnérables aux aléas des pratiques culturales. Avec leur approche d’ingénierie, les Deschambault visent à rendre l’aéroponie viable à une échelle industrielle. Leur solution : dans un bâtiment à environnement contrôlé, commencer la production à partir de la semence, permettant d’éliminer l’introduction de pathogènes du milieu extérieur. Les bénéfices : augmentation de la rapidité de production, réduction des ressources, élimination des intrants toxiques.
L’approche de CycloFields permet à l’heure actuelle une maitrise de la culture de la laitue; toutefois, le Défi Cultiver l’innovation d’ici spécifiait que les technologies développées par les équipes devaient produire des petits fruits, dont la fraise «La production de la fraise est beaucoup plus difficile; elle nécessite entre autres des variations de température et de lumière. Comme mon père disait, qui peut plus, peut moins — la maitrise de la fraise permettra de nous ouvrir de nouvelles portes» raconte Éric Deschambault.
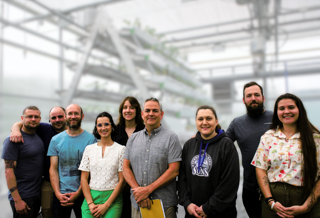 L’équipe du Collège Boréal et de Agri-Tech North.
L’équipe du Collège Boréal et de Agri-Tech North.Pour lui, ce défi suit la progression naturelle de son cheminement dans le secteur alimentaire. «J’avais déjà une entreprise de conservation de fruits et légumes en environnement contrôlé, explique-t-il. Je voyais l’ampleur des défis auxquels on faisait face pour nourrir la planète — étalement urbain, réduction des terres cultivables, réchauffement climatique.» L’aéroponie, qu’il a découverte en cherchant des pistes de solution, était toute désignée pour des conditions où les ressources sont limitées.
Benjamin Feagin Jr. d’AgriTech North comprend lui aussi les enjeux au cœur du Défi. La région du nord-ouest de l’Ontario où il a établi son entreprise fait face à d’importants problèmes de sécurité alimentaire. Selon lui, «Notre défi est le manque de production locale. Nous avons de moins en moins d’agriculteurs, beaucoup de retraités sans plan de relève, donc la situation ne va pas s’améliorer de sitôt sans apporter de changement.». Et le problème s’accentue plus on monte vers les communautés isolées du nord.
Au sein de l’équipe chapeautée par le Collège Boréal, un établissement d’études postsecondaires établi notamment à Sudbury, Ottawa et Toronto, M. Feagin développe une serre de production conçue pour résister à des conditions climatiques extrêmes. L’inspiration vient de BC Place à Vancouver : il s’agira d’un tout nouveau type de serre gonflable en éthylène tétrafluoroéthylène (ETFE), un plastique translucide résistant avec des propriétés isolantes. «Les technologies que l’on développe sont spécifiquement conçues pour que les petites communautés rurales éloignées puissent en bénéficier.», explique M. Feagin.
En plus d’AgriTech North, le Collège Boréal a réuni dans son équipe l’entreprise Truly Northern pour le volet agriculture verticale en intérieur, et la Rural Agri-Innovation Network, un OBNL à l’écoute des producteurs du nord de l’Ontario. Ils développent ensemble «un système complet qui pourrait être assemblé dans des communautés éloignées pour faire pousser des aliments à longueur d’année de manière verte», explique Sabine Bouchard, gestionnaire Recherche & Innovation au Collège Boréal. En plus de chapeauter le projet, le collège y contribue avec sa technologie d’abeilles vectrices — une nouvelle approche pour lutter contre les ravageurs : les abeilles, en butinant, répandent un pesticide doux à travers la serre.
Les onze équipes présentes au forum du 5 décembre y étaient parce qu’elles ont pu franchir avec succès la plus récente étape du Défi Cultiver l’innovation d’ici, la Phase du berger. Ces équipes ont obtenu un appui d’un million de dollars pour la réalisation d’un prototype fonctionnel de leur projet afin de recueillir des données de performance.
Au terme de cette période d’essais, en janvier 2025, les quatre projets les plus prometteurs du groupe de onze passeront à l’étape suivante — la Phase de mise à l’échelle. La Fondation de la famille Weston appuiera alors ces quatre équipes en contribuant cette fois cinq millions de dollars sur trois ans au développement des projets en vue de leur commercialisation.







