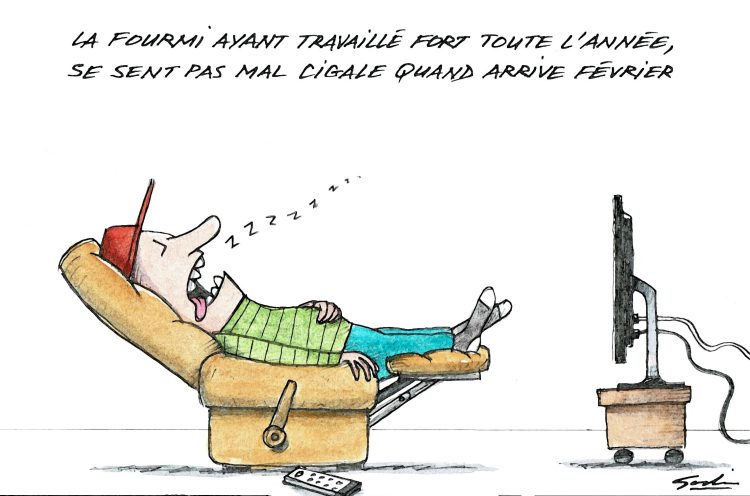Prévenir la propagation de l’influenza aviaire est une expérience complexe, mais vivre une éclosion en est une éprouvante. Une chose est réelle toutefois, rien ne laisse présager que le virus disparaîtra de notre radar avec l’hiver qui approche. Il faudra apprendre à vivre avec la menace.
Lors d’un webinaire organisé par les Éleveurs de volaille du Québec le 10 novembre 2022, le professeur Jean-Pierre Vaillancourt de la Faculté de médecine vétérinaire de l’Université de Montréal et spécialiste des maladies infectieuses avicoles expliquait qu’il ne voit pas comment on ne retrouverait pas le virus le printemps prochain. Depuis 2014-2015, les épisodes d’influenza aviaire hautement pathogène se sont multipliés à une vitesse Grand V à travers la planète. On parle d’une soixantaine de pays touchés et de plus d’un milliard d’oiseaux affectés.
Une expérience éprouvante
À lire aussi

Ils reviennent déçus de leur visite de fermes porcines danoises
Les producteurs de la Ferme Les Cochons du Roy de Saint-Michel-de-Bellechasse, sont revenus déçus de leurs visites de fermes porcines au Danemark.
Au Québec, les premiers cas dans les élevages commerciaux sont arrivés chez Canards du Lac Brome et chez cinq fermes de dindons à Saint-Gabriel-de-Valcartier. Lors du webinaire, l’éleveuse de dindons Jennifer Paquet de Saint-Gabriel-de-Valcartier a expliqué comment il est long le chemin vers le repeuplement. Elle a vu l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) prendre possession de son site d’élevage. Loin de leur en vouloir, elle a apprécié le travail de ces gens qui apprenaient à construire l’avion en plein vol. « C’est quasiment comme des mesures de guerre », dit-elle.
La ferme Avipro a quatre dindonnières sur le site touché. Les activités de sensibilisation auprès des employés et les mesures de biosécurité mises en place n’ont pas suffit à empêcher la contamination de la ferme. Un oiseaux sauvage est entré dans le bâtiment le 11 juin, ce qui pourrait être la cause. Une autre ferme située à 800 mètres a été déclarée positive le 29. Le 1er juillet, Jennifer Paquet visite le lot de 10 000 oiseaux presque prêts pour l’abattage. « Vraiment, quand je les ai regardés, je les ai trouvés beaux », dit-elle. Aucun signe de maladie. Le lendemain, elle reçoit un message d’un employé qui l’informe que le nombre de morts est anormal : sept. Puis, un autre message : le nombre est maintenant d’une vingtaine. Aucun autre signe clinique qu’une augmentation fulgurante des mortalités n’avait été observé.
L’ACIA a immédiatement été appelée. Toute l’équipe est arrivée dans les heures qui ont suivies et ils ont pris les échantillons avec l’aide d’un employé retraité de la ferme. Il faisait très chaud et les habits de protection rendaient la situation difficile à vivre. La productrice devait répondre aux nombreuses questions de l’Agence. « Ils avaient carrément pris possession de notre ferme », raconte Jennifer Paquet.
Le dépeuplement s’est passé rapidement. Les oiseaux dans le bâtiment infecté étaient vraiment malades, mais les mâles dans les trois autres bâtiments ont dû être également euthanasiés, même s’ils étaient très beaux et ne présentaient pas de signe. Selon l’Agence, ce n’était qu’une question de temps avant qu’ils soient malades. Les poulaillers ont été scellés tout en laissant une ouverture pour permettre à l’air de sortir alors qu’ils injectent le gaz. Les oiseaux n’ont pas souffert. Ils se sont endormis. Les carcasses ont été compostées sur place avec de la ripe fraîche. Tout doit être détruit : copeaux de bois, moulée, carcasses, fumier et ripe fraîche. Le tout sous haute surveillance. Tous les jours, l’Agence vient prendre des tests à tous les 20 pieds.
Une fois qu’ils reçoivent la lettre leur disant que le virus est éliminé, l’étape suivante était le nettoyage et la désinfection, en commençant par le nettoyage à sec. « Tout ce qui ne pourra pas être lavé à grande eau devra disparaître », dit-elle. À chaque étape, l’ACIA revient sur place pour s’assurer qu’il ne reste plus de trace potentielle du virus sur tout le site. Pendant ce temps, les fiches de santé pour chacun des autres élevages en cours doivent être complétés. « On doit aussi commencer à travailler sur nos demandes d’indemnisation parce que les oiseaux euthanasiés sont dédommagés. Par contre, ça ne se fait pas sans qu’on ait à soumettre une panoplie de documents », dit-elle. Les protocoles de lavage et désinfection de l’éleveur doivent être aussi approuvés par l’Agence. Cette étape est tellement longue et tellement cruciale qu’il a fallu que les employés acceptent de travailler jour et nuit pour y arriver. Certains endroits jamais lavés auparavant ont dû être nettoyés. « Quand on dit que c’est un lavage à la brosse à dent, c’est littéralement ça », dit-elle. L’inspection du nettoyage a duré cinq heures à deux personnes. « On a été très très chanceux de pouvoir compter sur notre personnel. C’est peut-être la note positive de cette mésaventure-là. C’est que ça l’a soudé, je crois, l’équipe », dit Jessica Paquet.
Trois mois après l’éclosion, le 4 octobre, des dindonneaux sont entrés dans le bâtiment à nouveau. Au final, elle explique que ça a été une expérience difficile, mais que les producteurs touchés de Valcartier ont soudé leurs liens. Un producteur a même créé un groupe Messenger.
La menace est dans votre cour
« Sachez que la menace est dans votre cour », a expliqué l’agronome Nathalie Robin des EVQ. Les mesures de biosécurité mises en place par l’EQCMA doivent être respectées. En cas de suspicion, l’éleveur doit s’autodéclarer, d’abord à l’ACIA, puis à l’EQCMA et aux Éleveurs de volaille du Québec.
Pour éviter la propagation de l’influenza aviaire, le Conseil de la transformation a mis en place des protocoles complexes de biosécurité pour les attrapeurs qui doivent se rendre sur les fermes. Un travail semblable a été fait par les Couvoiriers du Québec.
La question des indemnités a été évoquée lors du webinaire. Les indemnisations prévoient la compensation pour ce qui est détruit, mais pas pour les pertes de revenus. Le président des Éleveurs de volaille, Pierre-Luc Leblanc, a expliqué que des discussions ont eu lieu avec la ministre fédérale Marie-Claude Bibeau pour lui faire comprendre cet enjeu. « Ça peut être très long avant que les revenus puissent revenir », dit-il. Il en découle un problème de liquidité pour les fermes touchées.