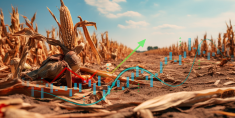J’ai eu et entendu cette question à plusieurs reprises dans les dernières semaines :
« Avec le mauvais printemps qu’on a et le risque qu’il se sème moins de maïs, est-ce qu’on peut s’attendre à de meilleurs prix à l’automne/hiver prochain ? »
Fichu de bonne question dont la réponse comporte à mon avis plusieurs nuances importantes.
D’entrée de jeu, rappelons que le prix au Québec repose sur trois paramètres importants : contrat à terme, base, et dollar canadien. Or, de ces trois paramètres, un seul est directement lié au contexte d’offre et demande de grains québécois, la base.
À lire aussi

Soya, les dés sont-ils joués?
Le marché du soya au Québec a été fort intéressant à l’automne dernier, grimpant à plus de 575 $CAN/tonne. Dans les faits, pratiquement chaque année, en début d’hiver, des stress météo du côté de l’Amérique du Sud font grimper le marché du soya à Chicago.
Mieux, pour avoir une pleine lecture de la situation, on doit écarter le facteur dollar canadien, ce qui veut dire qu’on parle bel et bien ici de la base en dollar américain (base $US) ou encore de la base ajustée.
Revenons maintenant à notre mauvais printemps. Si les prochaines récoltes sont mauvaises au Québec, c’est dire qu’on devrait voir tôt ou tard la base $US s’apprécier. Malheureusement, ce n’est pas si simple que ça…
Si la base $US est le meilleur reflet de l’offre et de la demande québécoise en grains, c’est aussi elle qui sert de « tampon ».
De quoi ? Oui, de tampon, c’est-à-dire de manière autant pour les acheteurs que les vendeurs d’encaisser les chocs des marchés boursiers et du dollar canadien. Prenons des exemples pour bien illustrer ce phénomène.
En 2012, lorsque le prix du maïs à la bourse de Chicago a atteint un record à plus de 8$US/boisseau (315 $US/tonne), les acheteurs québécois n’ont tout simplement pas été en mesure de suivre la parade. On peut ici prendre pour exemple un producteur de porc qui n’était pas à même de couvrir ses frais pour produire son porc. Après tout, le prix du maïs à l’achat avait à ce moment plus que doubler en l’espace de seulement quelques semaines.
Résultat, même si à Chicago, les écrans indiquaient que le maïs devait se transiger à 8$US/boisseau, concrètement dans le marché local québécois, les acheteurs n’étaient pas en mesure de payer ce prix pour opérer de manière saine leurs opérations. Or, le dernier mot ne revient jamais à ce qui est affiché à Chicago, mais plutôt à ce que les acheteurs locaux sont prêts à offrir pour assurer leurs approvisionnements. Du 8$US/boisseau, ceux-ci ont donc appliqué une « base négative » pour ramener le prix final à quelque chose de plus « sensé » pour continuer d’opéré.
L’opposé est tout aussi vrai…
Prenons comme second exemple les deux dernières années qui ont vu le prix du maïs touché à quelques reprises des creux importants à Chicago autour de 3,10 $US/boisseau (118 $US/tonne). Cette fois-ci, ce sont plutôt les producteurs de grains qui ne font pas leur frais à ce prix. Faisant abstraction du dollar canadien, on sait que dans la dernière année le 1er objectif de vente était plutôt de 200 $ la tonne. On est loin de notre 3,10 $US/boisseau. Comme le dirait mon collègue ontarien Philip Shaw, dans ce cas-ci, la base devient l’ajustement nécessaire à apporter au prix affiché par Chicago pour faire sortir le grain des silos. La base est donc ici positive contrairement à 2012.
Dans les deux cas, mauvaises ou bonnes récoltes au Québec, la base aura aussi servi de « tampon » pour encaisser les sauts d’humeur de la bourse.
Sachant ainsi que la base $US se veut le meilleur reflet du contexte d’offre et demande de grains au Québec, mais qu’elle peut servir également de tampon au jeu de yoyo des marchés boursiers, il devient plus simple de répondre à LA grande question qui nous intéresse.
Nous avons essentiellement quatre scénarios devant nous :
1 – Mauvaises récoltes au Québec et aux États-Unis : Les prix grimperont assurément. Par contre, bien que la base devrait s’apprécier en raison de la mauvaise récolte québécoise, elle devra aussi composer avec la pression à la baisse que lui imposera la hausse des prix à Chicago. Ce reste néanmoins le meilleur scénario, car les acheteurs seront dans l’impasse d’assurer leur approvisionnement sur tous les fronts.
2 – Mauvaises récoltes au Québec, mais bonnes aux États-Unis : Les prix au Québec profiteront d’une excellente base. L’offre de grains au Québec sera faible, et l’effet tampon du marché boursier sera à son meilleur. Par contre, concrètement, les prix des grains au Québec seront décevants, car le prix à Chicago sera faible.
3 – Bonnes récoltes au Québec, mauvaises récoltes aux États-Unis : La base sera alors à son pire avec une bonne disponibilité de grains au Québec, et l’effet tampon négatif de la hausse des prix à la bourse. Toutefois, il y alors fort à parier que les prix des grains eux-mêmes seront plus intéressants, ceux-ci profitant des meilleurs prix à la bourse. C’est ce qui s’est produit en 2012.
4 – Bonnes récoltes au Québec et aux États-Unis : Le prix des grains au Québec risque d’être désappointant à nouveau. Oui, la base profitera alors de l’effet tampon à la hausse en raison des faibles prix à Chicago. Par contre, elle devra aussi composer avec une offre locale importante, ce qui viendra freiner toute envolée des prix au Québec. C’est ce que nous visons d’ailleurs cette année.
De ces quatre scénarios, pour le moment, on retient les numéros un et deux. Maintenant, à savoir si les prix seront plus intéressants à l’automne repose non pas sur notre mauvais printemps, mais sur ce qui se passera davantage dans les prochaines semaines aux États-Unis côté météo. Il n’est donc certainement pas mauvais d’y jeter un coup d’œil pendant qu’on surveille les dernières prévisions météo pour poursuivre les travaux aux champs chez-nous.