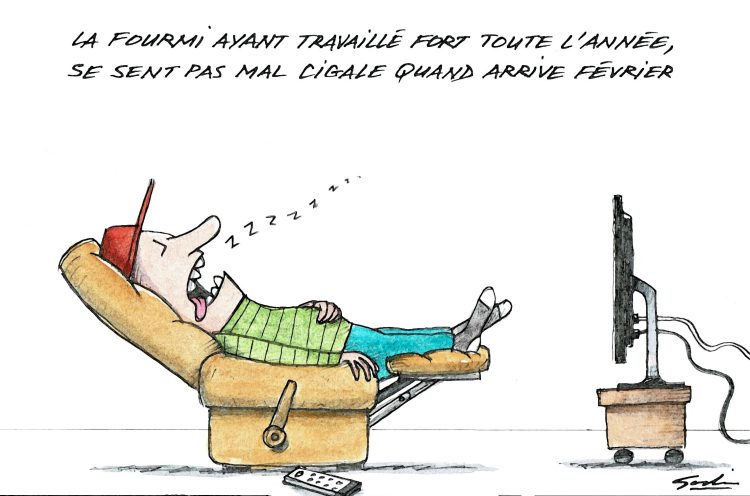D’ici 2050, il fera de plus en plus chaud. Dans ce sens, quel sera l’impact sur les plantes fourragères et surtout que devrons-nous faire pour s’y adapter?
Le chercheur Guillaume Jégo d’Agriculture et Agroalimentaire Canada à Québec et Sylvestre Delmotte, consultant pour le projet Agriclimat, ont présenté la situation future pour le Québec lors du Colloque sur les plantes fourragères organisé par le Centre de référence en agriculture et en agroalimentaire du Québec (CRAAQ) le 20 février 2020 à Sainte-Julie, en Montérégie. De son côté, le chercheur Valentin D. Picasso, de l’Université du Wisconsin, a présenté la résilience et l’adaptation des systèmes fourragers aux changements climatiques.
De plus en plus chaud
À lire aussi

Des céréales secouées par le dollar américain
Les turbulences économiques et politiques aux États-Unis ont fait grimper les céréales avec le blé comme gagnant de la semaine.
Au cours des trois dernières décennies, la NASA a observé une accélération de la hausse de la température de la planète. Les prédictions pour les 30 prochaines années démontrent que la hausse continuera alors que les émissions de gaz à effets de serre pourraient augmenter de 50% d’ici 2050.
À l’échelle du Québec, cela pourrait se traduire par une augmentation de température de 3°C d’ici 2050. Ouranos prédit qu’il y aura moins de vagues de froids extrêmes, plus de vagues de chaleur, plus longues et plus chaudes. Bref, il y aura plus de canicules. De plus, il y aura probablement plus d’événements de pluies extrêmes et plus intences, ainsi que davantage de cellules orageuses localisées et intenses.
L’automne sera plus doux, l’hiver plus court et avec plus de redoux. Il y aura aussi plus de précipitations totales sous forme de pluie. Les risques de formation de glace seront plus grands. Mais ce sera très variable d’une année à l’autre. Tout cela aura un impact négatif sur l’endurcissement des plantes fourragères.
Pour s’adapter, il faudra éviter les coupes trop tardives et trop rases, recommandent Guillaume Jégo et Sylvestre Delmotte. De plus, des clôtures végétales ou des haies brise-vent sont des exemples d’actions qui pourraient aider à la survie à l’hiver.
La fonte de la neige sera plus tôt et la saison de croissance sera plus longue avec plus de périodes chaudes. Par conséquent, il y aura plus de pertes d’eau des plantes par évapotranspiration. Elles auront besoin de plus d’eau, mais les précipitations ne seront pas plus élevées. Il y aura aussi plus d’évaporation de l’eau des cours d’eau, ce qui limitera l’utilisation de l’irrigation.
Il sera probablement possible de récolter une coupe de plus en 2050, ce qui occasionnera un rendement plus élevé. La luzerne aura une place de choix dans les mélanges. La fléole sera probablement remplacée en raison de sa faible résistance à la sécheresse. Elle sera probablement remplacée par la fétuque élevée
Résilience et adaptation
Selon le chercheur Valentin D. Picasso, trois concepts sont à retenir pour les systèmes fourragers pour le futur : productivité, stabilité et résilience.
« Il n’y a pas d’espèce parfaite en toutes situations, et parce qu’il n’y a pas d’espèce parfaite, il faut utiliser davantage de mélanges fourragers », dit-il. C’est une forme d’assurance. Parfois, ça peut même procurer une meilleure qualité de fourrages pour le bétail.
C’est pourquoi le chercheur insiste sur l’importance de la diversité et du choix de l’espèce. Il suggère même d’inclure dans les rotations des cérérales pérennes comme l’agropyre intermédiaire. De plus les rotations incluant des plantes fourragères bénéficiera aux cultures de céréales comme le maïs et le soya. Pour les printemps pluvieux, les pâturages pourraient être avantageux alors qu’on ne peut pas récolter les fourrages.