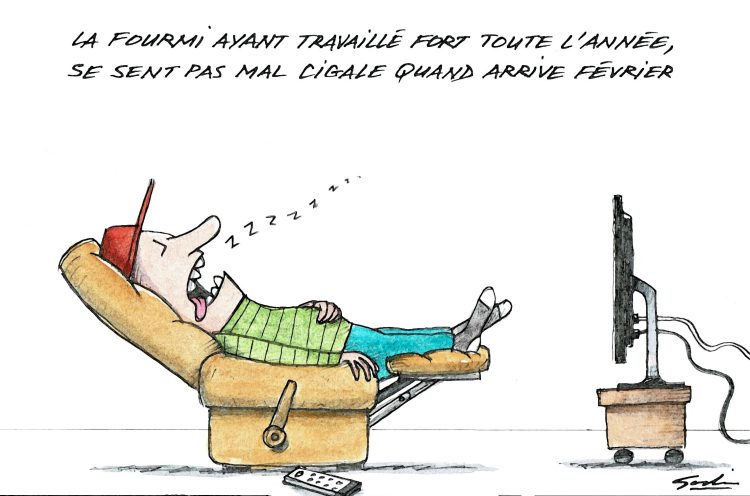*Des producteurs s’attèlent à diminuer leur production de gaz à effet de serre à la ferme. C’est le cas de Jocelyn Cossette de la Ferme Joviane. Chez cette entreprise céréalière et maraîchère de 400 hectares, les émissions se chiffrent à 1448 tonnes. La ferme a réussi à séquestrer 230 tonnes.
Celui qui fait partie des premières cohortes d’Agriclimat réalise aussi deux activités de recherche dans le cadre du Laboratoire vivant Racines d’avenir. Il a reçu l’aide d’une équipe de spécialistes composée de Martin Chantigny d’Agriculture et Agroalimentaire Canada, son agronome Éliane Martel du Club Lavi-Eau-Champ et de l’agronome et chercheuse Marie-Élise Samson de l’Université Laval.
5 stratégies
À lire aussi

De nouveaux produits pour les érablières
Le secteur acéricole se développe à vitesse grand V. Voici un aperçu des nouveautés offertes par les fabricants et manufacturiers pour la prochaine saison des sucres.
- Boues de papetière
Annuellement, Jocelyn Cossette épand de 2500 à 3000 tonnes de boues. La ferme a même aménagé une plateforme de réception. Après un blé de printemps, suivi d’un nivellement, on en a appliqué (35 t/ha) suivi d’une incorporation à la déchaumeuse. Les boues émettent un peu d’azote, mais elles augmentent surtout la matière organique du sol. Alors qu’il dosait 2 % du temps de la charrue, il est aujourd’hui de 4,6 %.
2. Cultures de couverture
Maïs, soya et blé : c’est après ce dernier que Jocelyn Cossette sème un couvert, composé en 2025 de radis fourrager et de trèfle incarnat. Comme il produit de la semence de blé, il ne peut introduire une autre graminée dans l’assolement. Le producteur privilégie d’autres familles botaniques, telles que crucifère et légumineuse qui fixent l’azote atmosphérique.
Avec les automnes qui allongent, Jocelyn Cossette penche vers ce que l’agronome et ingénieure Odette Ménard du MAPAQ appelle la rotation de fertilité, pour séquestrer du carbone et intercepter l’azote résiduel sous forme organique stable.
« En cas de récolte hâtive du soya, je pourrais semer comme couvert le blé de printemps que je ressèmerais le printemps suivant. En 2025 dans le maïs, j’essaierai le ray-grass intercalaire. J’aurais même le temps, après le blé, de faire deux couverts en détruisant le premier dès sa floraison, vers la mi-septembre. »
3. Démarreur organique
Sur 10 hectares, un démarreur granulaire appelé l’Humarine et produit par OrganicOcean de Rimouski, a été testé. À base d’algues et de sous-produits des pêcheries, ce démarreur présente une plus faible empreinte carbone qu’un engrais azoté de synthèse ayant été fabriqué avec du gaz naturel. Cet engrais contient aussi des éléments mineurs et des composés organiques biostimulants qui favorisent l’absorption des éléments nutritifs.
4. Dose d’azote
Pour diminuer les émissions azotées, Jocelyn Cossette mise sur la contribution de la matière organique et le fractionnement des opérations en trois actes : incorporer en présemis 50 unités d’azote appliquées à la volée, placer 50 unités en bande au planteur et compléter la fertilisation azotée avec 50 ou 70 unités (selon le seuil de 4 % de matière organique), pour un total de 150 ou 170 unités.
5. Inhibiteurs d’uréase et de nitrification
Le 21 octobre 2024, Jocelyn Cossette complétait sa récolte de maïs (18 % d’humidité), un record. Dans le champ no 23, on a retiré les caissons d’échantillonnage des gaz avant le moissonnage. Préalablement pour la fertilisation, on a répliqué à quatre endroits le dispositif suivant : deux moments d’application de l’urée (présemis et post-levée), deux doses (50 et 70 unités), avec et sans inhibiteurs. Les inhibiteurs ou stabilisateurs améliorent la disponibilité de l’azote en réduisant les pertes par volatilisation, lessivage et dénitrification.
L’inhibiteur de l’uréase agit sur l’enzyme dans le sol qui catalyse la transformation de l’urée en dioxyde de carbone et ammoniac. L’inhibiteur de la nitrification retarde la conversion de l’ammonium en nitrates en inhibant une enzyme de la bactérie Nitrosomonas. Les inhibiteurs permettraient une baisse de 30 à 40 % des émissions. Jocelyn Cossette les a utilisés sur l’ensemble de ses 85 ha de maïs, à un coût de 11 $/ha. « Mon objectif n’est pas nécessairement de diminuer beaucoup mes doses d’azote, mais d’espérer qu’elle reste utile en cas de déluge, comme celui du 9 août, quand il est tombé 135 mm de pluie! »
*Cet article d’Étienne Gosselin est une version tirée et adaptée du magazine Le Bulletin des agriculteurs, édition de janvier 2025. Pour lire l’article en entier, abonnez-vous au magazine où plus de contenu exclusif est disponible.
À lire aussi: