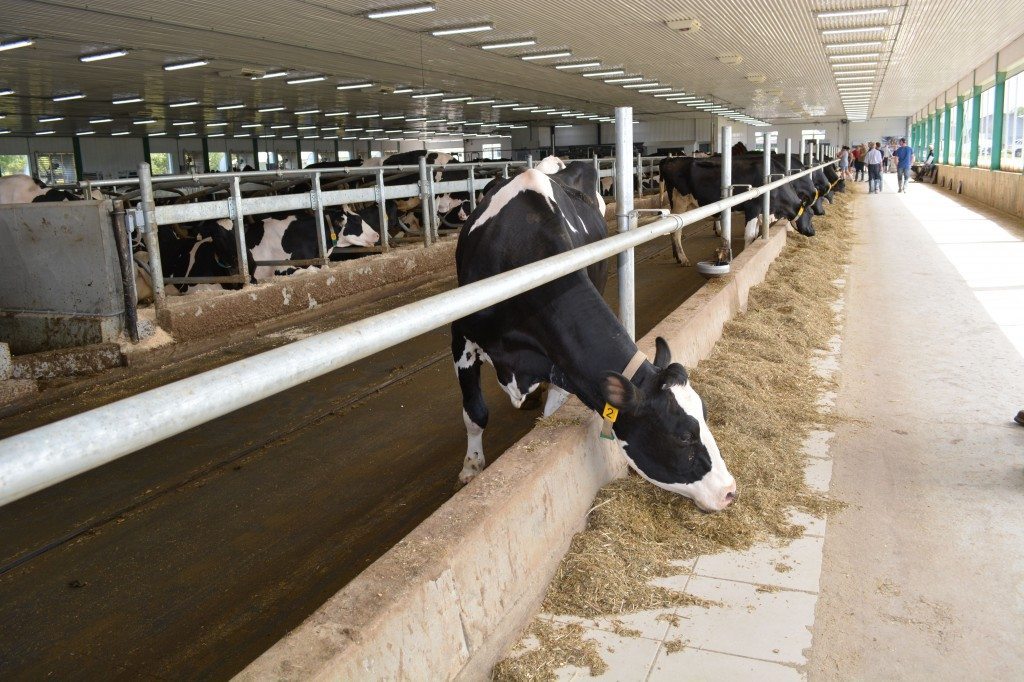La production d’ensilages englobe à la fois les ensilages d’herbe, de maïs ou de céréales, ce qui implique que les bonnes pratiques énumérées dans l’article sur la prévention de la production de mycotoxines au champ pour la production de grain peuvent s’appliquer aussi pour la production d’ensilage. Voici une série de conseils spécifiques à la production d’ensilage qui permettront de réduire la contamination et la production de mycotoxines dans vos ensilages. De plus, ces conseils vous aideront à obtenir un ensilage de meilleure qualité en général et à réduire votre coût de production :
À lire aussi

Les mycotoxines démystifiées : La prévention aux champs pour la production de grain
Comme dirait l’adage, il vaut mieux prévenir que guérir, et c’est pour cette raison que dans cet articles, nous allons discuter des moyens qui peuvent être mis en place pour réduire la prévalence du Fusarium graminearum dans les cultures puisque c’est l’espèce de champignon produit les toxines la plus fréquente au Québec. Voici une liste de bonnes pratiques aidant à réduire la prolifération de ce champignon au champ :
- Choisir des fourrages avec une concentration en sucre soluble permettant d’accélérer et d’augmenter la concentration d’acide lactique et ainsi réduire le pH de vos ensilages lors de la période de fermentation;
- Choisir des hybrides résistant aux maladies fongiques/moisissures;
- Effectuer la récolte de l’ensilage de maïs à un taux d’humidité optimal pour assurer un rendement, une valeur nutritive et une fermentation optimale;
- Accélérer le séchage des fourrages aux champs en effectuant des andains larges pour réduire la période pendant laquelle les fourrages sont exposés à l’air et aux intempéries;
- Maintenir une hauteur minimale de coupe de 4 pouces lors de la fauche;
- Hacher les fourrages récoltés pour optimiser la compaction lors de l’entreposage et ainsi réduire la présence d’air dans le silo;
- Décharger l’ensilage dans les silos de façon hygiénique pour ainsi éviter la contamination avec le sol;
- Compacter les meules, silo-couloir ou Agbag pour obtenir une densité minimum de 240 kg de matière sèche/m3;
- Respecter les recommandations en termes de matière sèche et de taille de la fibre selon la taille de vos silos-tours;
- Fermer convenablement vos silos, meules ou balles rondes/carrées avec du plastique pour créer rapidement des conditions anaérobiques. Particulièrement pour les silos horizontaux et les meules, une barrière à oxygène réduit grandement la pénétration de l’oxygène dans la masse. Surtout, n’oubliez pas de réparer les trous qui pourraient se former;
- Utiliser des silos d’une taille appropriée vous permettant de retirer de l’ensilage fermenté à un rythme suffisant pour éviter la détérioration aérobie et le développement de moisissures et de levures.
- Le taux de reprise optimal de vos ensilages devrait être d’un minimum de 10 cm en hiver et 20-30 cm en été pour éviter le développement des moisissures et la détérioration aérobie;
- Pour les silos-meule, couloirs ou en sacs, utiliser les équipements nécessaires lors de la reprise pour obtenir une façade de silos lisse et ferme. Cela réduira le contact avec l’oxygène, donc la détérioration par les moisissures et les levures;
- Le taux de reprise optimal de vos ensilages devrait être d’un minimum de 10 cm en hiver et 20-30 cm en été pour éviter le développement des moisissures et la détérioration aérobie;
- Lorsque la situation le demande, utiliser des acides organiques comme l’acide propionique pour améliorer la stabilité aérobie;
- Utiliser un inoculant hétérofermentaire tel que Lactobacillus buchneri combiné à des inoculants homofermentaires pour accélérer la réduction du pH des ensilages qui empêchent le développement de moisissures lors de la reprise et améliorent la stabilité aérobie.
Nous espérons que ces pistes de solutions pourront vous aider à produire de meilleurs ensilages, moins contaminés en mycotoxines.
N’oubliez pas de demander l’aide de votre agronome pour vous assurer que vous adoptiez les pratiques les mieux adaptées pour votre entreprise.
Merci à Madame Carole Lafrenière et Monsieur Jean-Phillipe Laroche pour leur collaboration.