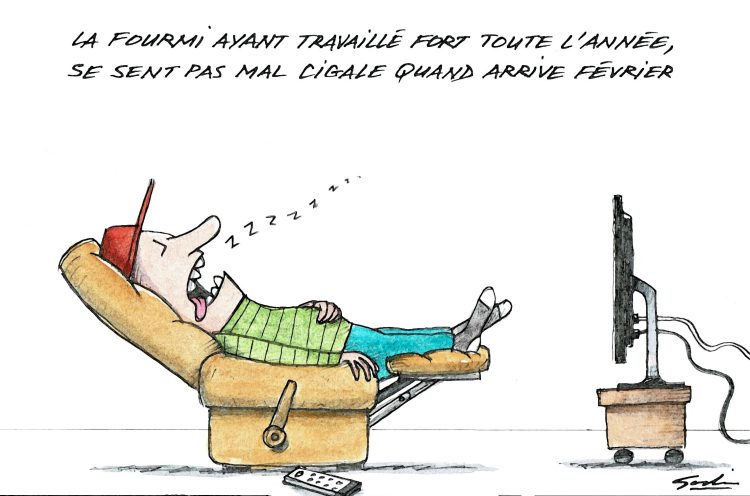« Un tien vaut mieux que deux tu l’auras », décrit bien comment on peut se sentir au début des semailles lorsqu’un sol froid formerait un beau lit de semence. Dans un tel cas, faut-il attendre le réchauffement du sol, au risque d’être confronté à des délais causés par la pluie, ou semer dès lors ?
La réponse est évidente pour beaucoup d’entre nous, surtout si on se rappelle le printemps 2019. Soulignons que le courant de pensée sur la température du sol à atteindre pour effectuer le semis du maïs et du soya a beaucoup évolué au fil des deux dernières décennies. Il n’y a pas si longtemps, on recommandait que la température du sol, mesurée à la profondeur habituelle du semis, ait atteint 10 degrés pour les semis de maïs et 12 degrés pour ceux du soya. Plus récemment, on s’est davantage penché sur la température de l’eau qui imbibe la semence, autrement dit, la température du sol durant les 24 à 48 heures qui suivent le semis. Par la suite, lorsque le processus de germination est enclenché, les semences deviennent plus résistantes au froid.
Des avancées dans les domaines des traitements de semences, des techniques de production des semences, de la sélection variétale et de la conception des semoirs permettent une meilleure émergence. Voyons-les, un à un. À l’époque où la semence était traitée au Captan ou au Thiram, il y avait très peu de protection contre la fonte des semis. Par surcroît, on n’utilisait pas de polymère, la distribution du traitement sur la semence était irrégulière et des parties de la semence étaient sans protection. Les traitements modernes sont plus efficaces sur un plus grand nombre de pathogènes.
À lire aussi

30 ans de maïs Bt: où en sommes-nous avec la pyrale?
Le maïs Bt-pyrale a célébré, en 2025, son 30e anniversaire de commercialisation au Québec. Cette technologie a eu un effet majeur sur la productivité de la culture. Toutefois, le spectre de la résistance de la pyrale commence maintenant à poindre à l’horizon.
Sur le plan des techniques de production de semences, les progrès sont marqués : chez le maïs, on tend à provoquer la précocité de la récolte, soit par des moyens mécaniques ou chimiques, afin de diminuer la taille des semences, mais aussi pour accélérer le processus de maturation. À noter que les semences de maïs de petits calibres sont moins propices à se fissurer lors de l’égrainage et du conditionnement. Dans le cas du soya, on utilise une panoplie de techniques pour éviter d’endommager les semences. Du point de vue du nettoyage de la semence, il existe maintenant des trieuses optiques qui détectent et éjectent les semences déformées et décolorées au moyen de micro-jets d’air. On les utilise dans beaucoup de cultures.
Pendant longtemps, la sélection d’hybrides de maïs se faisait dans des parcelles où l’on uniformisait la densité des peuplements par un éclaircissage manuel des plantules. Or, cette approche, maintenant révolue, dissimulait la mauvaise levée de certains génotypes. De nos jours, on sélectionne activement pour une meilleure levée des hybrides en voie de commercialisation.
Certes, ne perdons pas de vue le risque qu’un gel puisse survenir à la fin mai ou au début de juin. Il faut donc s’assurer de ne pas semer si tôt que la culture atteint un stade où les dégâts causés par un gel seraient irréversibles. Ce raisonnement motive les producteurs de grandes cultures à semer le maïs avant le soya, puisque le méristème de cette céréale reste à l’abri du gel, sous le sol, jusqu’au stade 3-4 feuilles. La partie aérienne du soya tolère plus longtemps des températures sous zéro que celle du maïs, mais une fois que le gel pénètre ses tissus et touche ses bourgeons dormants, il n’y plus de possibilité de reprise.
Cependant, dans des cas moins tragiques, où seules les feuilles sont gelées et que la tige et les bourgeons sont épargnés, le soya se tire mieux d’affaire que le maïs puisqu’il supporte mieux la variabilité du stade de croissance provoquée par une reprise inégale. Pour ceux qui sont à l’aise de courir le risque, on observe une tendance à semer le soya avant le maïs aux États-Unis. Peu importe que vous semiez le maïs ou le soya en premier, si les conditions de semis des derniers jours d’avril s’y prêtent, il n’est pas nécessaire d’attendre que la température du sol atteigne le seuil de 10 degrés. Il faut toutefois éviter de semer la veille d’une bordée de neige ou d’une forte pluie qui frôle le point de congélation.
Lire d’autres blogues Entre deux rangs avec Jean-Marc Montpetit ici.
Lire aussi: Semis: quelques points à vérifier avant d’aller aux champs