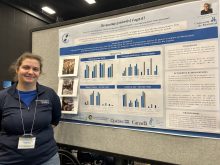Une équipe de recherche d’une université canadienne utilise la métagénomique dans une nouvelle approche pour identifier les maladies causées par des bactéries, des agents pathogènes et des virus.
Les travaux sur la génomique sont en cours depuis un certain temps dans d’autres secteurs de l’industrie agricole, mais ce n’est que récemment qu’ils ont été appliqués aux bovins de boucherie.
L’étude du matériel génétique provenant d’échantillons environnementaux a changé la façon dont les cultures sont sélectionnées, dont les maladies sont traitées et dont la composition génétique des animaux est comprise.
À lire aussi

Bœuf : les impacts environnementaux, au-delà des GES
La viande bovine a des impacts économiques, sociétaux et environnementaux qui vont bien au-delà d’un simple calcul de GES. Entrevue avec le chercheur Rodolpho Martin Do Prado de l’Université Laval.
Ceci est intéressant puisque la métagénomique peut tester de nombreux types d’agents pathogènes à la fois et ne nécessite qu’un seul échantillon.
Recherche sur les bovins de boucherie
Chez les bovins de boucherie, la recherche en génomique a débuté dans le domaine du diagnostic des maladies et de la compréhension des maladies, des bactéries et des virus.
Cheryl Waldner, professeure et chercheuse au Western College of Veterinary Medicine, fait partie des chercheurs travaillant sur la recherche métagénomique chez les bovins de boucherie et s’intéresse plus particulièrement aux maladies respiratoires bovines.
Ses travaux sont en cours au Centre d’excellence en élevage et en fourrage (CEEF) dans le cadre du réseau de surveillance vache-veau et constituent un précurseur des travaux qui seront possibles grâce aux nouvelles installations de l’Université de la Saskatchewan et du CEEF.
Avec les méthodes actuelles de diagnostic des maladies, un échantillon est prélevé et soumis à un test ciblé pour la maladie suspectée. Le test le plus courant est la PCR, qui détecte du matériel génétique spécifique, comme l’ADN ou l’ARN, afin de déterminer la maladie. Cependant, ce test ne détecte qu’une seule maladie à la fois, par échantillon.
« En fin de compte, avec les tests actuels, je ne peux pas trouver un bug si je ne sais pas ce que je cherche la plupart du temps », a expliqué Cheryl Waldner lors de la journée sur le terrain du CEEF 2025, en juin 2025.
« Je pourrais tomber dessus par hasard, mais à moins d’avoir un plan… ils vont probablement le rater », a-t-elle ajouté.
Grâce au séquençage métagénomique, il n’est pas nécessaire de déterminer au préalable une bactérie spécifique. Ce type de test permet d’identifier simultanément les espèces connues et inconnues, puis de fournir des données permettant une analyse plus approfondie à tout moment.
Cela signifie également qu’un seul échantillon est nécessaire pour le test, et qu’il n’est pas nécessaire de le conserver en permanence pour des analyses ultérieures ou de prélever un nouvel échantillon. Cela réduit les besoins et les coûts de stockage de ces échantillons, car leur conservation sur de longues périodes peut être coûteuse.
« C’est comme si j’avais un livre et que je cherchais des mots spécifiques dans un livre, je pourrais peut-être trouver ces mots spécifiques (avec les anciens tests) », a-t-elle expliqué.
« C’est plutôt comme ouvrir le livre et lire réellement les lignes de l’histoire, lire tout ce qui s’y trouve et essayer de déterminer si c’est pertinent ou non et s’il y a quelque chose d’utile ou non. »
À partir d’un seul échantillon soumis au séquençage métagénomique, Cheryl Waldner est en mesure d’obtenir des informations sur les maladies respiratoires, les bactéries de la conjonctivite et la résistance aux antimicrobiens.
Cheryl Waldner a notamment appliqué ses recherches en étudiant le nez des veaux, qui contient une grande quantité de bactéries en raison de leur présence constante à l’extrémité des pattes de leurs compagnons de troupeau.
Le séquençage métagonomique l’a aidée à en apprendre davantage sur les agents pathogènes des maladies respiratoires, car le processus peut fournir de nouvelles informations sur les agents pathogènes qui étaient auparavant difficiles à identifier ou à mieux connaître.
Les bactéries présentes sur le nez d’un veau sont liées aux excréments de l’animal, ce qui peut être pertinent pour la santé du troupeau, la santé publique et la surveillance. Cependant, pour les recherches de Cheryl Waldner, elles offrent un aperçu inédit du fonctionnement de la résistance génétique aux antimicrobiens.
« Ce n’est pas seulement un gène présent dans un échantillon, a-t-elle dit. C’est un gène présent dans un échantillon, lié à une bactérie et à tout un ensemble d’autres gènes de résistance. Et, soit dit en passant, il est attaché à une valise, une cassette ou un élément génétique mobile qui emballe le tout de manière élégante et le rend extrêmement contagieux. Et on le voit aussi lorsqu’il est présent. »
Dans ses recherches sur les maladies respiratoires, elle a pu facilement identifier Mycoplasma bovis ainsi que d’autres mycoplasmes connus pour causer des problèmes, mais pour lesquels il n’existe pas de tests de diagnostic commerciaux.
Portée plus grande
Grâce à ces recherches et au séquençage métagénomique, Cheryl Waldner a également étudié comment vacciner les veaux contre le coronavirus en tant que maladie respiratoire, plutôt que seulement contre la diarrhée. Elle a indiqué que l’une de ses études fournit des preuves extrêmement solides du lien entre le coronavirus et les maladies respiratoires chez les veaux.
Elle a indiqué qu’une grande partie du virus est présente chez les veaux, mais que dans les troupeaux de vaches-veaux, il n’existe pratiquement aucun gène de résistance aux antimicrobiens lorsqu’on examine les agents pathogènes respiratoires par séquençage génomique ou par des méthodes de mesure traditionnelles. Cela signifie que les chances de vaccination et de traitement efficace sont élevées.
« Nous avons vraiment une idée de test universel, a-t-elle dit, et cela a très bien fonctionné. Nous pouvons détecter les virus attendus : la rhinotrachéite infectieuse bovine (IBR), la diarrhée virale bovine (BVD) et le virus respiratoire syncytial bovin (BRSV). Nous pouvons les détecter, mais aussi tout un tas d’autres virus que nous ne testons pas aussi souvent. »
*Article de Janelle Rudoph paru dans Farmtario, traduit et adapté par Marie-Josée Parent.