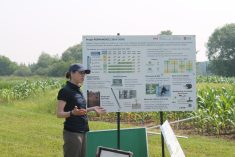La dégradation physique des sols au Québec a des conséquences financières directes pour les entreprises agricoles, selon le professeur du département des sols et de génie agroalimentaire de l’Université Laval, Jean Caron. Son diagnostic est alarmant. L’état de santé physique des sols est critique, particulièrement dans la grande zone de production de grains (Montérégie et Centre-du-Québec). Les recherches menées au Québec révèlent une dégradation avancée, mesurée par des indicateurs cruciaux comme la porosité d’air, la conductivité hydraulique et la diffusion des gaz.
« Les sols en monoculture sont compactés à 90 % au niveau de la couche arable, mais également plus en profondeur, au-delà de 25 à 50 cm », dit-il.
Ce compactage généralisé nuit à l’aération et affecte directement la respiration des racines et des microbes, menaçant ainsi le cycle de l’azote. Une autre façon de mesurer la qualité d’une terre arable, c’est la présence de lombrics. Leur rôle est souvent comparé à celui d’ingénieurs de l’écosystème en raison des nombreux bénéfices qu’ils apportent au sol. En creusant leurs galeries (macropores), les vers de terre créent des canaux stables qui facilitent l’infiltration de l’eau de pluie et l’aération du sol. Cela réduit le ruissellement en surface et aide à décompacter le sol.
La situation s’est aggravée avec le temps
À lire aussi

Questions et réponses sur la gestion de l’eau en agriculture
Doubler ou non les drains, le coût financier d’un tel projet et les effets d’un sol dégradé sur la rentabilité figurent parmi les sujets abordés lors d’un récent webinaire du CRAAQ.
L’évolution de la dégradation sur les 50 dernières années est claire : une perte généralisée de matière organique, un tassement accru et une diminution de la capacité de drainage profonde des sols majeurs du Québec : « Une perte de productivité importante est associée à cette dégradation, de l’ordre de 1 à 2 % par an », souligne le professeur Jean Caron.
Il met en garde contre une tendance à l’inaction qui compromet la viabilité à long terme de l’agriculture. L’analyse des coûts sur 25 ans révèle que la dégradation des sols n’est pas seulement un problème agronomique, mais une urgence financière :« La perte de productivité amène une diminution graduelle de rentabilité qui menace sur une échelle de 10 à 15 ans la survie même de l’entreprise productrice de grains ».
Cette situation est aggravée par des dépenses supplémentaires en azote et en énergie, et par une chute des rendements dans les zones les plus dégradées. Enfin, les changements climatiques vont accentuer cet impact, en prolongeant les conditions humides en surface du sol, ce qui augmente la perte de l’azote et réduit la respiration de la plante.
Des solutions connues, mais sous-utilisées
Les causes sont bien identifiées : baisse de matière organique, équipements surdimensionnés, absence de cultures à enracinement profond. Heureusement, les solutions existent et sont largement documentées : retour aux rotations culturales, dont le fourrage, l’apport accru de matière organique, réimplantation de bosquets et réduction de la taille des équipements. Le professeur souligne que le problème est réversible : « Les sols dégradés, lorsqu’ils sont remis en rotation, ont la capacité de récupérer sur une échelle de 10 à 20 ans et de maintenir des niveaux de productivité qui assurent la rentabilité financière. »
Ces pratiques sont d’ailleurs alignées sur celles promues en Europe pour la restauration des sols.
À noter que Jean Caron prononcera une conférence sur le sujet le 10 décembre prochain à Drummondville dans le cadre du colloque Santé des sols, pourquoi s’y engager organisé par le Centre de référence en agriculture et agroalimentaire du Québec (CRAAQ).
Pour lire d’autres articles AGRInnovant et bonnes pratiques, cliquez ici.