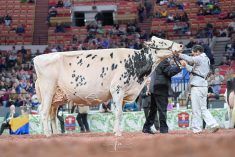Québec (Québec), 7 septembre 2001 – « Le gouvernement fédéral, par l’entremise de son ministre des Pêches, vient encore une fois d’asséner un dur coup à l’économie des régions maritimes du Québec ». C’est en ces mots que le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, M. Maxime Arseneau, a commenté la récente décision fédérale concernant le partage interprovincial du flétan noir.
À lire aussi

Bœuf : les impacts environnementaux, au-delà des GES
La décision de Polytechnique de retirer la viande bovine de ses menus ne tient pas compte de plusieurs facteurs environnementaux. Entrevue avec un chercheur de l’Université Laval.
Le ministre Dhaliwal a en effet annoncé sa décision de réduire la part des pêcheurs québécois de flétan noir. « En accordant aux pêcheurs du Québec 82 % de la ressource et 18 % aux pêcheurs de Terre-Neuve, le ministre fédéral renie tous ses principes d’allocation de la ressource », a indiqué le ministre Arseneau. Selon les principes d’historique, de contiguïté de la ressource et de dépendance, l’industrie du Québec aurait dû bénéficier de 95 % de l’allocation.
Cette décision entraîne des pertes considérables pour les régions maritimes du Québec et plus spécifiquement pour la Gaspésie puisque la pêche au flétan noir génère 900 emplois saisonniers sur les bateaux et en usine, et que six usines de transformation tirent leur revenu principal de cette ressource.
Le non-respect des parts historiques québécoises au cours des années 1995-2000, uniquement dans la pêche au flétan noir, représente des pertes économiques évaluées à plus de 2 000 tonnes métriques d’une valeur au pêcheur de 3,5 millions de dollars et de près de 6 millions de dollars à la sortie d’usine. Ce sont plus de 100 emplois saisonniers qui sont ainsi perdus, accentuant les impacts négatifs sur l’industrie et les régions maritimes du Québec.
Cette dernière décision fédérale contre le Québec s’ajoute à une longue série de décisions tout aussi inéquitables qui, depuis une vingtaine d’années, ont entraîné une diminution dramatique de la part relative des débarquements québécois dans l’atlantique de 35 %. « Ce qui est encore plus désolant et révoltant, c’est que le fédéral s’attaque encore une fois à une clientèle particulièrement vulnérable puisque la majorité des pêcheurs concernés sont dépendants de cette espèce. Le fédéral vise à faire mourir à petit feu l’industrie québécoise des pêches mais nous ne nous laisserons pas faire », a indiqué le ministre Arseneau.
« À quoi sert de mobiliser tous les intervenants régionaux et de mettre en œuvre, comme nous l’avons fait au cours des dernières années, une série de mesures visant à soutenir et relancer l’économie de nos régions maritimes si, au même moment, le gouvernement d’Ottawa cède aux pressions politiques des provinces de l’Atlantique et nous refuse l’accès à une juste part de la ressource halieutique » de conclure le ministre, qui, du même souffle invite les acteurs régionaux concernés à se joindre à lui pour dénoncer l’attitude de mépris du fédéral vis-à-vis des communautés maritimes du Québec.
Informations complémentaires relatives à la problématique du partage interprovincial du flétan noir ci-dessous.
Informations complémentaires
La problématique du partage interprovincial du flétan noir remonte en 1995, alors que l’industrie du Québec s’est montrée très préoccupée par l’accroissement de la participation des pêcheurs de Terre-Neuve dans cette pêche compétitive. En effet, les pêcheurs du Québec ont développé la pêche au flétan noir et ont capturé plus de 95 % de la ressource jusqu’en 1990, alors que l’effondrement des stocks de poisson de fond a incité les pêcheurs de Terre-Neuve à réorienter leur pêche. Contrairement aux pêcheurs du Québec, qui sont dépendant du flétan noir et ont peu accès à d’autres ressources, les pêcheurs de Terre-Neuve disposent de permis multiples leur permettant de réorienter leur activité lorsqu’un stock est en moins bon état.
En 1995, le ministre fédéral avait établi un partage temporaire de 82 % pour les pêcheurs du Québec et de 18 % pour les pêcheurs de Terre-Neuve. Ce partage, dénoncé par les pêcheurs du Québec, avait été maintenu pour les deux années suivantes, mais en 1998, le ministre fédéral David Anderson l’avait modifié à 85 % – 15 % et à 88 % – 12 % en 1999. C’est donc dire que le ministre fédéral de l’époque considérait que le partage à 82 % – 18 % était inéquitable et qu’il fallait faire un ajustement à la faveur des pêcheurs du Québec.
À l’automne 1999, le ministre fédéral a mandaté un groupe indépendant afin de lui faire des recommandations relativement au partage inter provincial. Le Québec s’est objecté dès le début à ce processus qui manquait de rigueur et de transparence. Alors que l’industrie du Québec nommait un représentant, de même que l’industrie de Terre-neuve, le ministre fédéral nommait le président. Un processus rigoureux aurait dû notamment s’assurer que le président serait co-opté par les deux parties en cause. Il est d’ailleurs à noter que le rapport du groupe « indépendant » est dissident, le représentant nommé par l’industrie du Québec s’étant dissocié des résultats en proposant plutôt un partage de 92 % pour le Québec et 8 % pour Terre-Neuve.
Finalement, soulignons que le partage historique de la ressource varie de 82 % – 18 % à 96 % – 4 %, toujours en faveur des pêcheurs du Québec, dépendamment de la période retenue. Pour la période 1979 à 1991, qui est la période retenue par le groupe de travail fédéral provincial sur les parts historiques parce que cette période est représentative d’une pêche relativement ordonnée et exclut la réorientation des pêcheurs lors de l’effondrement des stocks de poisson de fond, le partage s’établit à 94 % – 6 %. La période retenue dans le rapport, et donc par le ministre fédéral, est celle de 1990 à 1994 et celle qui pénalise le plus l’industrie du Québec.
Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :
Ministère de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ)
http://www.agr.gouv.qc.ca/