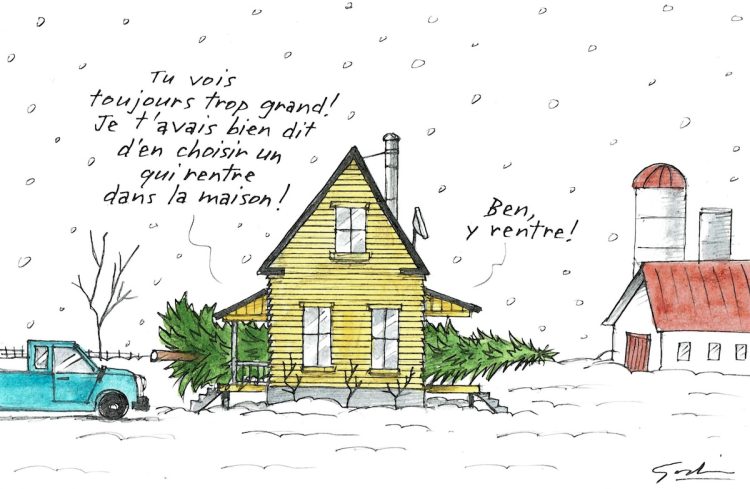Plusieurs dizaines de chercheurs, d’agronomes et de conseillers agricoles convergeront vers Québec afin d’assister au congrès du Réseau québécois de recherche en agriculture durable (RQRAD) qui aura lieu du 11 au 13 février. Créé dans le cadre de la Politique d’agriculture durable (PAD) du Québec, le RQRAD veut faire percoler les connaissances et les avancées scientifiques en agriculture en facilitant le réseautage et la coopération entre chercheurs, tout en favorisant la relève scientifique.
Pour cette quatrième édition, une journée entière sera consacrée à l’agriculture de précision et au traitement de données. La deuxième journée portera davantage sur le contexte socioéconomique dans le cadre d’une agriculture durable, alors que la troisième offrira un point de vue global sur certaines problématiques en agriculture.
En étant intégré dans le PAD, le Réseau a pour mission explicite de mobiliser la recherche sur la réduction de l’usage des pesticides et leurs risques pour la santé et l’environnement, ainsi que d’améliorer la santé et la conservation des sols. C’est pourquoi on trouve une panoplie de résultats de recherches sur ces sujets qui seront communiqués dans le cadre du congrès.
À lire aussi

Le soya efface ses gains des derniers mois
Les nouvelles des derniers jours ont ramené le prix du soya tel qu’il était à la fin du mois d’octobre.
Après quatre ans d’existence, la directrice adjointe, Louise Tremblay, jette un regard plutôt satisfait sur les réalisations du RQRAD. Lancé en pleine pandémie, le réseau rejoint maintenant un peu plus de 250 chercheurs provenant de 16 institutions universitaires, de plusieurs centres de recherche provinciaux et fédéraux et de Centres collégiaux de transfert de technologie (CCTT). Les organisateurs du congrès s’attendent d’ailleurs à accueillir plus de 200 personnes durant les trois jours de l’événement. « C’est un peu notre happening de l’année. Il y a des ateliers de cocréation et de la formation tout au long de l’année, mais le congrès est un endroit où les gens ont l’occasion de voir où on en est rendu en recherche et de réseauter », dit-elle.
En étant à peu près à mi-mandat du PAD, dont l’échéance est en 2030, quel est le constat pour le moment des résultats obtenus par le RQRAD? Louise Tremblay indique que l’organisme a déjà mené des consultations sur le sujet. Elle peut dire que le reste du mandat sera en continuité avec les deux axes poursuivis depuis les débuts, soit la réduction des pesticides et la conservation des sols. Une volonté est exprimée pour ouvrir un à deux axes supplémentaires qui seraient le transfert de connaissance vers les utilisateurs, ainsi que la biodiversité. L’aspect socioéconomique pourrait également être plus développé. « On souhaite aller vers des choses un peu plus concrètes », ajoute-t-elle.
Il faudra voir toutefois ce que donnera l’étude des crédits au gouvernement dans le cadre du prochain budget provincial. Louise Tremblay précise que le PAD dispose d’encore un an et demi de financement. Quand on sait que les projets de recherche sont élaborés sur trois à quatre années, il serait dommage de voir ces derniers être interrompus par manque de financement.
Le ministre du MAPAQ, André Lamontagne, doit ouvrir le congrès le 11 février, ce qui est vu comme un bon signe. Avec un budget de 25 M$ pour 24 projets en cours, les résultats sont déjà là. « Je suis tout de même optimiste pour le financement. En seulement quatre ans, on a réussi à mobiliser les chercheurs en agriculture. »