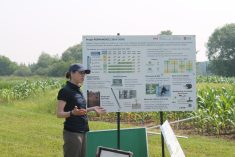Nos sols sont-ils de bonne qualité ou mieux encore, sont-ils en santé? La question se pose alors que les champs au Québec sont de plus en plus soumis à des extrêmes météo qui mettent à rude épreuve leur capacité à encaisser les périodes difficiles. Les années 2019 et 2020 en seraient des bons exemples et la variabilité des cultures et des rendements reflèterait des problèmes plus profonds, au sens littéral. La structure du sol serait en effet en cause dans bien des cas. « Durant les années d’extrêmes, c’est là où les problèmes ressortent », avance Louis Robert, agronome à la Direction régionale de la Montérégie, secteur Est. Pour lui, une bonne structure de sol est un élément clef de l’adaptation de l’agriculture face aux changements climatiques.
À lire aussi

Agronomes recherchés pour participer à une étude
Dans le cadre de la politique visant à réduire l’utilisation des pesticides, une étude se penche sur le rôle des agronomes qui accompagnent les producteurs vers l’atteinte de cet objectif.
L’agronome a abordé la question lors d’un webinaire présenté par le CRAAQ le 29 septembre dernier. Tout comme les humains, fait-il valoir, le sol peut être en bonne ou mauvaise santé, mais pour le savoir, il faut analyser la situation et poser le bon diagnostic.
Plusieurs outils existent pour faire un bilan de santé. L’analyse de sol, l’étude des cartes par Infosols et les cartes pédologiques sont de bons points de départ. Rien ne vaut toutefois une pelle, un couteau de poche et un ruban à mesurer, selon l’agronome. La méthode est assez simple et permet de faire des observations précieuses. Il recommande de creuser un trou assez profond (76 cm à 81 cm) et large (61 cm à 76 cm) et de répéter l’opération pour comparer deux endroits différents dans le champ, soit une bonne zone et une moins bonne. Le maniement de la pelle permet d’observer la densité et la structure du sol puisque la variabilité des différentes couches sont de nombreux indices sur son état de santé.
Au moment de creuser, Louis Robert recommande de porter une attention particulière aux mottes de terre. « Un des meilleurs indices, c’est de regarder comment elles se défont. » On recherche une texture grumeleuse avec de petits agrégats composés de matières organiques.

La même texture de sol (argileux) et une belle structure grumeleuse. Photo : Louis Robert, MAPAQ
Les zones grises compactées reflètent un manque d’oxygène et donc l’absence de fer oxydé, tandis que la présence de tunnels de vers de terre indiquent s’ils sont en grand nombre et à quelle distance de la surface. Des racines s’étalant à l’horizontal ou courtes sont un autre indice de sols compactés, un problème de plus en plus présent, selon l’agronome. « L’air dans le sol est essentiel », fait valoir l’agronome. Les terres en Montérégie montrent d’ailleurs une diminution de la présence d’air qui ne compose plus que 10% de la structure du sol, alors que le niveau idéal est de 25%. Sans aération, les racines étouffent et la vie microbienne est plus rare.
Une structure de sol assez fine, mais pas trop, va permettre aux racines de multiplier leur capacité à aller chercher des nutriments et à résister aux changements climatiques. Louis Robert a comparé les racines de plants de maïs dans 12 fermes montrant des problèmes de compaction. En comparant diverses zones dans le champ, les racines démontraient une différence de 77% dans leur poids.
L’agronome ajoute qu’il faut aussi savoir utiliser le bon remède. Le drainage doit servir à abaisser le niveau de la nappe d’eau et non pas à assécher la surface. De même, un champ nivelé va peut-être permettre d’écouler les eaux de surface, mais seulement en raison de la pente. Selon des observations au champ, « 85% des eaux de précipitations s’écoulent de manière horizontale, alors que cela devrait être le contraire. Les eaux de surface devraient descendre vers la nappe phréatique. » D’ailleurs, la rapidité d’infiltration de l’eau est de 80% à 90% plus rapide selon la structure du sol.
Mais remettre un sol en santé prend du temps et de la patience. Il faut s’attendre à un délai entre le changement de pratiques et les résultats. La santé des sols est toutefois un enjeu important. « Le profil de sol devrait être la 1re étape de tout « plan de relance » d’une entreprise agricole », conclut Louis Robert.