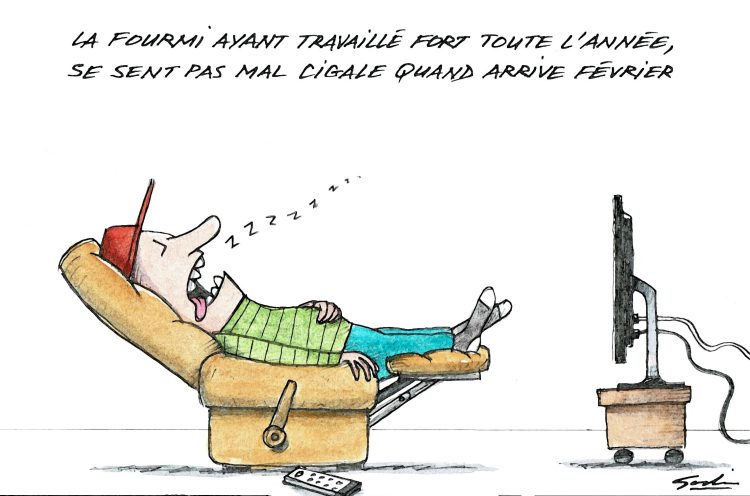En régie biologique, les producteurs n’utilisent pas d’engrais. Parfois, ils épandent du fumier, mais plus souvent c’est une combinaison entre la rotation, l’utilisation d’engrais vert et parfois l’application de fumier qui va permettre de fertiliser les cultures.
La conseillère du secteur biologique pour la région de Montréal-Laval-Lanaudière-Laurentides au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ) Murielle Bournival explique qu’en régie biologique, le plus important, c’est la santé des sols. Cette agronome a précédemment travaillé pendant huit ans au CETAB+ comme conseillère en agroenvironnement. Il faut s’assurer d’une bonne structure du sol et faire attention à la compaction. « Si un sol n’a pas une bonne structure, on a beau mettre le double de fumier, on n’aura pas le rendement escompté », dit-elle.
Une bonne rotation comprend un minimum de trois cultures : maïs, soya, céréale et engrais vert l’année de récolte de la céréale. « On ne recommande jamais maïs-soya comme rotation parce qu’un précédent soya ne fournira jamais assez d’azote pour un maïs, dit-elle. Un retour d’engrais vert, ça peut vraiment fournir l’azote nécessaire à un maïs. » Un engrais vert de légumineuses utilisés l’année précédant la culture de maïs va permettre l’apport en azote nécessaire à la culture.
À lire aussi

Des céréales secouées par le dollar américain
Les turbulences économiques et politiques aux États-Unis ont fait grimper les céréales avec le blé comme gagnant de la semaine.
Murielle Bournival explique que parce qu’il y a de plus en plus de fermes en régie biologique, les fumiers deviennent de plus en plus rares. Les producteurs doivent donc innover pour faire en sorte que leur système produise sans fumier. Certaines entreprises réussissent bien. À défaut d’avoir beaucoup de recherche, des fermes effectuent des tests avec l’aide d’agronomes.
La technique du semi direct est plus compliquée en agriculture biologique. « Au niveau travail réduit, l’enjeu c’est toujours les mauvaises herbes », explique Murielle Bournival. Pour contrôler, les mauvaises herbes, les producteurs combinent plusieurs approches. Souvent la charrue sera utilisée une fois durant la rotation. De plus, les équipements de sarclage d’aujourd’hui offrent un grand niveau de précision de telle sorte qu’il n’est pas rare de voir des champs en régie biologique exempts de mauvaises herbes. Mais pour cela, le producteur doit être très consciencieux.
En biologique, les engrais verts sont beaucoup utilisés pour fertiliser, parfois dans la céréale ou après. Toutefois, pour une question de structure du sol et pour un contrôle l’année suivante, il faut faire un travail du sol. Murielle Bournival explique que c’est souvent une critique de la culture biologique, mais c’est souvent indispensable pour le contrôle des mauvaises herbes.
Murielle Bournival précise toutefois que les cultures en régie biologique sont plus résilientes qu’en culture conventionnelle. « Souvent, quand on compare deux producteurs qui sont côte à côte dans une même région, dans les années où les conditions climatiques ne sont pas adéquates, souvent en bio, les producteurs vont s’en tirer plus qu’en conventionnel… surtout dans les périodes de sécheresse », dit Murielle Bournival.
Depuis 10 ans, l’écart de production entre le conventionnel et le biologique a diminué de beaucoup, passant de 20 à 25% en 2011 à moins de 10% aujourd’hui. En revanche, le biologique représente 30% plus de travail en raison du travail mécanique et de la multiplication des opérations.
Murielle Bournival explique qu’en conventionnel, les producteurs ont l’avantage de pouvoir appliquer de l’azote. « C’est le facteur limitant en biologique », dit-elle. Pour ce qui est de la fertilisation, l’agronome recommande aux producteurs de travailler avec leur agronome et de faire des essais.