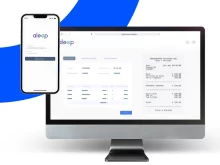Un document d’orientation suggère que des changements dans les institutions pour atténuer l’impact des charges financières pourraient soutenir les petites exploitations sans nuire aux plus grandes.
Les données de Statistique Canada indiquent que le nombre de fermes de taille moyenne est en constante diminution tandis que les fermes comparativement grandes et très grandes gagnent en taille et en nombre.
Selon l’Institut canadien des politiques agroalimentaires, un groupe de réflexion sur l’économie agricole basé à Guelph, la tendance actuelle présente des risques pour le secteur dans son ensemble. Mais quels sont les facteurs qui pourraient arrêter la diminution des fermes canadiennes de taille moyenne s’interroge l’Institut?
À lire aussi

Le Canada conclut un accord avec la Chine sur les questions agricoles
En voyage en Chine, le premier ministre Mark Carney annonce une entente qui mettra fin aux droits de douane sur plusieurs produits agricoles, dont le canola.
Dans un document d’orientation publié le 2 novembre par l’Institut, ce dernier soutient que la communauté agricole du Canada a tenu les institutions et les normes agricoles pour acquises en ce qui a trait à leur fonctionnement et leur stabilité. Ces dernières incluent les exigences au niveau de la sécurité routière pour l’équipement et le fonctionnement de l’équipement, les normes de sécurité du travail et le fonctionnement des processus de règlement des différends, des offices de commercialisation et de diverses autres institutions sectorielles.
« Nous avons une vision institutionnalisée où ces choses n’ont pas vraiment été un problème pour nous, pour autant que je sache, mais elles ont été uniques [au secteur] », déclare Al Mussell, directeur de recherche pour l’Institut et auteur du document.
« Alors que nous évoluons d’une manière telle que les fermes en tant qu’entreprises commerciales semblent être de plus en plus éloignées des ménages, ces exemptions, ces résolutions de différends… ça va être plus difficile à régler. Cela crée des coûts dans le système. »
Ces coûts, selon M. Mussell, sont probablement l’un des facteurs qui contribuent à la non-viabilité à long terme des exploitations agricoles de taille moyenne. Alors que les grandes exploitations peuvent tirer parti du capital pour, par exemple, absorber les coûts élevés des nouvelles technologies, acheter plus de quotas, se permettre de naviguer dans les réglementations du travail, etc., les petites exploitations sont de moins en moins en mesure de la faire dans les structures actuelles, entraînant inévitablement des pertes.
Le problème inverse est aussi vrai. À mesure que les fermes deviennent plus grandes et apparemment plus éloignées des ménages – une image dont les familles agricoles canadiennes profitent grandement – les décideurs et le grand public peuvent trouver de plus en plus difficile de permettre à l’agriculture canadienne de maintenir ses propres règles et institutions parallèles.
«Ce sont des problèmes très complexes. Ce n’est pas comme si les grandes exploitations étaient en fait déconnectées des ménages, mais la perception est qu’elles le sont », explique M. Mussell. « C’est une discussion difficile à avoir à certains égards, mais néanmoins, cela se produit…. C’est un problème en quelque sorte caché à la vue de tous. »
Il est donc nécessaire de se rappeler que les institutions, les politiques et les conventions établies depuis longtemps sont sujettes à changement, et en fait pourraient devoir être modifiées pour s’adapter aux réalités socio-économiques actuelles du secteur.
Pour M. Mussell, la difficulté consiste à déterminer comment les changements qui soutiennent les petites entreprises agricoles peuvent être mis en œuvre sans nuire aux grandes exploitations – ces dernières faisant partie intégrante de l’efficacité et de la compétitivité du secteur dans son ensemble. La recommandation est plutôt de construire un dialogue « autour d’une collaboration et d’institutions renouvelées pour faciliter un renouvellement de la diversité ».
M. Mussell suggère un certain nombre de pistes qui pourraient être explorées : faciliter l’accès aux marchés contrôlés par quotas; alléger le fardeau des coûts d’équipement; partage de la propriété des machines et l’élargissement des options quant au règlement des différends.
La meilleure solution à adopter n’est pas évidente. Cependant, M. Mussell pense que toute action doit commencer par une plus grande prise de conscience : les tendances actuelles sur les structures agricoles pourraient entraîner des changements perturbateurs. Pour les atténuer ou les éviter, les institutions du secteur doivent être fonctionnelles, entretenues et redéployées.
Source: Farmtario, Matt McIntosh (traduit de l’anglais)