Pourquoi cultiver des plantes fourragères et surtout quelles sont les principales préoccupations des acteurs du secteur? C’est ce qu’un travail approfondi, mené par le Pôle-PFQ (plantes fourragères Québec) depuis un an, a essayé de déterminer pour connaître les besoins du milieu et mieux arrimer la recherche.
Les besoins sont en effet importants pour la culture qui a connu des années de déclin au Québec, mais qui semble vivre un regain d’intérêt face à ses capacités de régénération des sols et de captation de carbone.
Les cibles de la recherche
À lire aussi
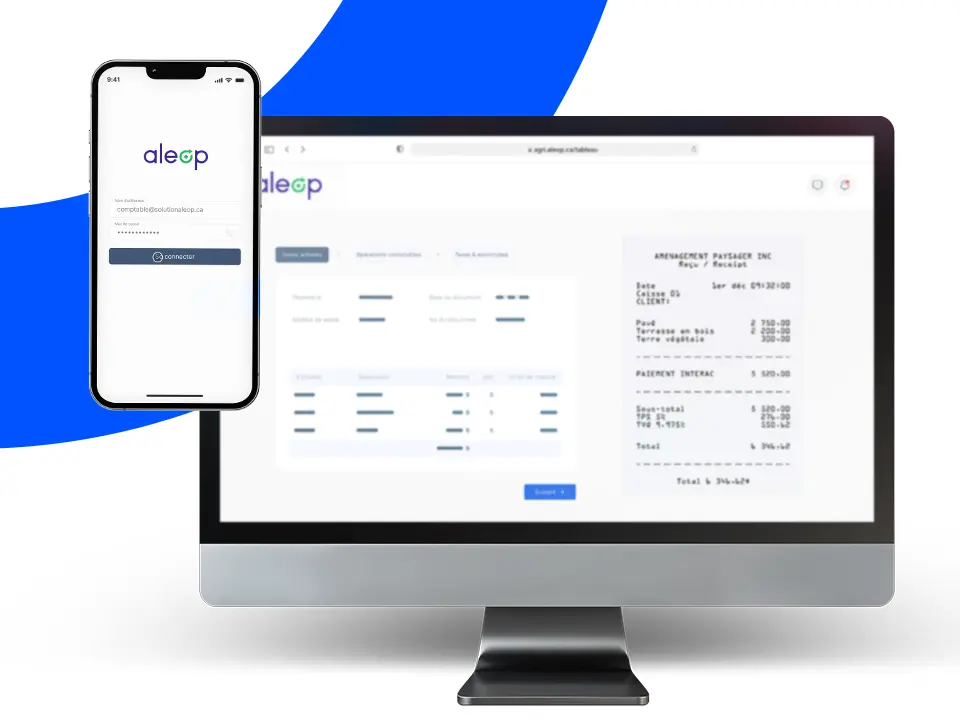
Aleop lance son application mobile
Aleop, la solution web dédiée à l’automatisation de la comptabilité des entreprises de l’OSBL CEGA – Centre d’expertise et de gestion agricole, offre maintenant à ses utilisateurs une application mobile liée à son outil informatique.
Le sondage mené en ligne l’an dernier par le Pôle-PFQ a permis de recueillir 350 préoccupations. L’environnement et les défis climatiques se situent au premier rang des préoccupations listées par les répondants. Le développement des pratiques pour optimiser le rendement et la valeur nutritive des plantes fourragères continuent également d’être une des priorités, explique Guy Allard, chargé de projet pour l’organisme, mais aussi ancien agronome et professeur à l’Université Laval.
La vitesse à laquelle se déroulent les changements climatiques place en effet le sujet en tête des champs à investiguer. Il préoccupe d’ailleurs autant les agriculteurs, les conseillers, que les chercheurs. Le Pôle-PFQ place l’adaptation des cultures et des pratiques pour de bons rendements dans ses priorités, tout comme la réduction de l’empreinte environnementale de l’agriculture. À cela se joignent de meilleures connaissances sur la rentabilité des plantes fourragères, ainsi que la formation et le transfert.
Il était important pour le Pôle-PFQ de ne pas faire de « liste d’épicerie », mais plutôt d’organiser toutes ces préoccupations sous des thèmes afin de ne pas orienter la recherche et d’explorer différents angles qui préoccupent autant les conseillers que les producteurs, indique Guy Allard.
Une ressource méconnue
Pour bien mettre la ressource de l’avant, il faut bien comprendre les coûts-bénéfices économiques, ce qui fait cruellement défaut en ce moment. « On peut savoir exactement quel est le rendement en maïs, mais on n’est pas capable d’avoir les chiffres pour les cultures fourragères. Dans les cultures fourragères, on va dire qu’on a fait tant de voitures de foin pour parler du rendement », illustre le chargé de projet. Il y a une absence d’éléments de comparaison, que ce soit pour le poids, le niveau d’humidité et de densité du foin récolté, ce qui complique énormément les calculs sur les coûts et le rendement de la culture. Il est essentiel de saisir la question de la gestion pour la comparer avec les autres cultures et améliorer les rendements, estiment les intervenants liés aux plantes fourragères.
Cette méconnaissance nuit, selon Guy Allard, à la culture qui a périclité face au maïs et au soya. Comme il est difficile de quantifier le retour en argent sur la ferme, il est plus facile de se tourner vers les grandes cultures qui sont bien documentées sur le sujet. Et comme ces dernières ont tendance à s’étendre vers l’est de la province avec les changements climatiques, les fourrages sont mis de côté, surtout que le prix des grains est excellent depuis deux ans.
C’est pourquoi il est aussi essentiel de chiffrer les avantages des cultures pérennes dans les rotations, ce qui n’existe que peu ou pas dans la littérature scientifique. « Le discours est aussi vrai pour la captation du carbone, surtout que les systèmes de rétribution sont différents au fédéral et au provincial. Le premier fonctionne selon des crédits, alors que le second adhère à la bourse du carbone de la Californie », indique-t-il.
Le maillon faible
Les préoccupations sur le climat et le rendement renvoient directement à un autre point, celui de la formation. « Il manque de gens pour transmettre les résultats de recherche aux producteurs », souligne Guy Allard. C’est la vulgarisation des livres au champ qui manque actuellement pour faire avancer la culture, en plus de l’accompagnement auprès des producteurs. « Souvent, ce sont des conseillers qui font des grandes cultures et qui vont s’occuper des cultures fourragères à la fin de la semaine, s’il reste du temps. C’est insuffisant pour faire un bon accompagnement », juge-t-il. Les producteurs ont besoin d’un accompagnement et d’un suivi pour s’adapter face aux changements climatiques, surtout que les plantes fourragères sont principalement cultivées pour les vaches laitières, d’où de grandes exigences face à la qualité du fourrage.
Un soutien du ministère
Le Conseil Québecois des plantes fourragères (CQPF) et le Pôle-PFQ (sous-division du CQPF) semblent toutefois avoir l’oreille du MAPAQ. Des rencontres doivent lieu avec le ministère pour parler des préoccupations et des priorités de l’organisme.
Le Plan d’agriculture durable est vu comme un pas dans la bonne direction pour renouveler l’intérêt des plantes pérennes, surtout que ce sont ces dernières qui permettent les plus grandes rétributions du programme, fait valoir Guy Allard.
Signe que le courant semble passer entre le MAPAQ et le CQPF, le ministre Lamontagne compte assister au prochain congrès du CQPF qui se tiendra le 16 mars.













