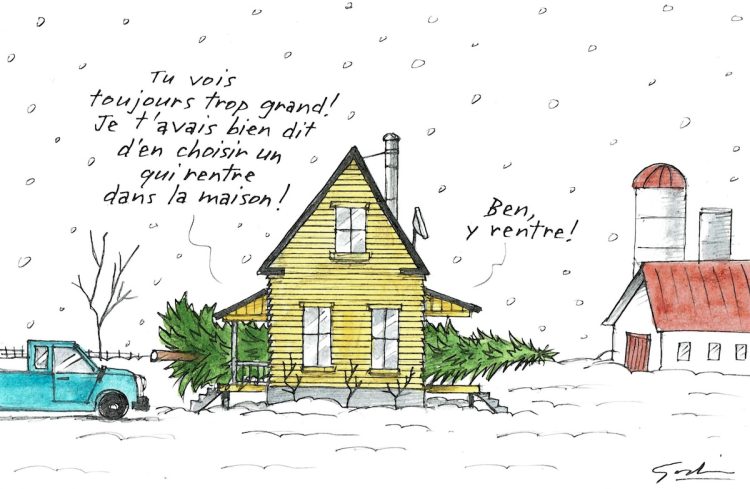Au Québec, on sème environ 400 000 ha de maïs, pratiquement tous avec un traitement de semence insecticide. Dans le soya, environ la moitié des 200 000 ha est ensemencée avec de la semence traitée.
« Est-ce qu’on a véritablement besoin de traitement de semence sur ces 500 000 ha? Les insectes ciblés par ces insecticides se retrouvent-ils dans tous ces champs? », a demandé la biologiste et entomologiste du CÉROM Geneviève Labrie, lors d’une journée Grandes cultures à Saint-Rémi en décembre dernier.
À lire aussi

Pour démystifier les biostimulants : conférence et panel
Beaucoup d’informations circulent sur les biostimulants, c’est pourtant difficile de bien les définir et de comprendre leurs utilisations et avantages. Pour remédier à la situation, Le Bulletin des agriculteurs organise une conférence et un panel sur les biostimulants.
Les traitements de semences sont l’un des suspects derrière le déclin des colonies d’abeilles dans l’hémisphère nord. Si les cas d’intoxications d’abeilles lors des semis sont bien documentés, l’impact sur ces pollinisateurs une fois que les semences ont germé demeure difficile à démontrer scientifiquement.
Que l’on se préoccupe ou pas sur le sort des abeilles, il y a lieu de revoir notre façon au Québec d’utiliser les traitements de semences de façon automatique et généralisée, affirme Genevière Labrie. « Le principe de base de la lutte intégrée, c’est d’utiliser une méthode de lutte quand un seuil de nuisibilité est atteint. »
Il s’avère qu’au Québec, la pression de plusieurs des insectes nuisibles pour lesquels les traitements de semences sont conçus est pratiquement nulle, notamment en début de saison.
Mouche des semis
Altises dans le canola
La culture du canola est en forte croissance et l’usage de traitements de semence est généralisé. Des dommages importants provoqués par les altises ont été rapportés en Abitibi-Témiscamingue et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ailleurs dans la province, les suivis du Réseau d’avertissements phytosanitaires (RAP) indiquent que le seuil d’intervention n’est pas atteint.
Ver fil-de-fer
Les larves de ce ravageur attaquent la semence, le germe ou la jeune plantule de maïs. Le problème est plus fréquent sur les retours de prairies, ce qui pourrait justifier l’usage d’un traitement de semence. Les dépistages menés par le RAP n’ont permis de trouver qu’un seul champ au Québec où la population de ver fil-de-fer pouvait justifier un traitement de semence.
Chrysomèle des racines du maïs
Puceron du soya
Des traitements de semence protègent le soya contre le puceron, mais seulement dans les 45 à 60 premiers jours après les semis. Au Québec, la plupart du temps, les infestations de pucerons se produisent plus tard, en juillet et août.
Les traitements de semences insecticides sont des produits toxiques, rappelle Geneviève Labrie. Lorsque comparés à des insecticides traditionnels, une dose dix fois inférieure suffit à tuer une abeille.
En 2011, un groupe de travail a été formé au Québec, composé de scientifiques, de représentants des semenciers et fabricants de traitements de semence et autres membres de l’industrie, afin de réfléchir et de proposer des moyens d’action pour réduire l’impact des traitements de semence sur les abeilles. D’ici peu, un guide de bonnes pratiques devrait voir le jour, ainsi que des instructions pour adapter les semoirs.