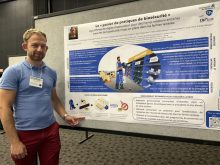Les mammites environnementales font de plus en plus partie du portrait des infections qui affectent le système mammaire des vaches québécoises. Une forte proportion de ces infections se produisent lors des deux semaines qui suivent le tarissement ou lorsque le système de défense de la vache est à son plus faible, dans les deux semaines après le vêlage.
Les mammites environnementales font de plus en plus partie du portrait des infections qui affectent le système mammaire des vaches québécoises. Une forte proportion de ces infections se produisent lors des deux semaines qui suivent le tarissement ou lorsque le système de défense de la vache est à son plus faible, dans les deux semaines après le vêlage.
À lire aussi

Vaches laitières: comment bien choisir les matériaux de surface de couchage
Chez la vache laitière, le bien-être animal est lié au confort de la surface de couchage. Comment s’y retrouver parmi les différentes options? Voici les critères pour choisir le bon matériau.
Parmi ces mammites, celle à Klebsiella est particulièrement redoutable. Elle est très difficile à traiter et occasionne des pertes d’environ 8 kg de lait suivant l’infection et de 5 kg de lait dans les mois subséquents, selon la chercheuse Ruth Zadoks de l’Université Cornell. La vache qui attrape ce type de mammite est plus susceptible de mourir ou d’être réformée que tout autre type de mammite. Les animaux qui survivent aux mammites à Klebsiella développent souvent des mammites chroniques, car le taux de guérison est faible.
Sources
Il est reconnu depuis longtemps que les litières à base de bois, notamment de sciures et copeaux de bois verts et humides, seraient une importante source de Klebsiella. Dans les dernières années, Klebsiella est également devenue un problème pour les troupeaux ayant adopté des litières exemptes de bactéries, comme le sable.
Le Quality Milk Production Services de l’Université Cornell (États-Unis) a démontré que des vaches en bonne santé peuvent également héberger des bactéries Klebsiella dans leurs intestins et excréter la bactérie dans leurs excréments. Une étude réalisée à l’Institut Miner de l’Université Cornell a démontré que Klebsiella pneumoniae, l’espèce la plus commune occasionnant la mammite, était présente dans le système intestinal de 80 % des vaches.
Cette situation implique que toute litière contaminée par du lisier peut héberger des bactéries de ce type. Selon la chercheuse Ruth Zadoks, les bactéries Klebsiella auraient été identifiées dans le fumier des vaches dans 67 % des situations, les allées de circulation (66 %), la litière (63 %), les membres de l’animal (59 %) et le pis (70 %).
Prévention
La contamination se propage par les écoulements de lait des animaux infectés et les excréments des vaches. L’adoption de mesures pour maintenir un niveau de propreté élevé pour les vaches et les installations aide à réduire considérablement le risque de contamination. Des mesures de prévention et contrôle des mammites environnementales sont proposées par les experts du réseau mammite :
– Éviter la contamination des trayons par le fumier, l’eau contaminée et la litière souillée.
– Fournir des stalles de grandeur et de conception adéquate pour éviter que les vaches se couchent en diagonale.
– Maintenir une litière adéquate, propre et sèche dans les logettes ainsi que dans les parcs de vêlage pour assurer le confort et la propreté de l’animal. Égale- ment, respecter une densité animale recommandée.
– Conserver les allées de passage, parcs d’attente et allées de sorties de la salle de traite aussi propres que possible.
– Éviter l’accès à des aires d’exercice boueux.
– S’assurer du bon fonctionnement du système de ventilation pour maintenir un environnement frais et sec.
– Adopter une technique de traite recommandée.
– Fournir des aliments frais et de l’eau à proximité après la traite pour qu’elles restent debout pour une période d’au moins 40 à 60 minutes.
– Éliminer graduellement les vaches porteuses chroniques qui constituent un foyer d’infection pour l’ensemble du troupeau.
– Éviter les écoulements de lait en regrou- pant les vaches qui perdent leur lait plus rapidement pour être traites en premier et par une sélection génétique rigoureuse pour ce caractère.
Sources : Hoard’s Dairyman et Flash-mammite
Article d’Alain Fournier