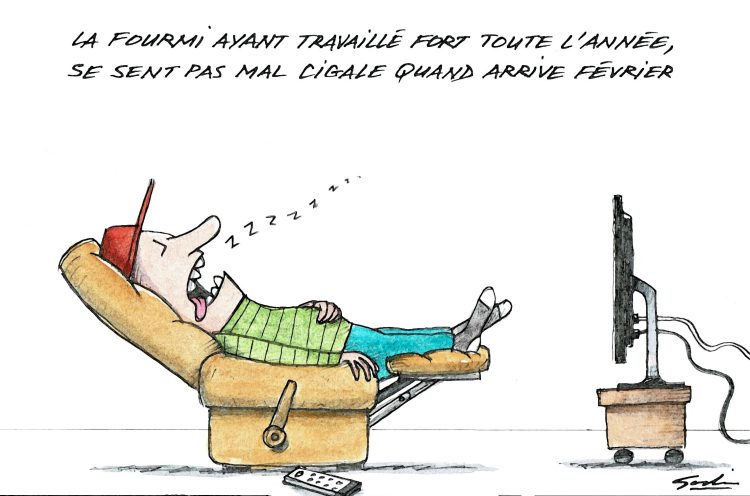Que faites-vous de vos analyses de fourrages lorsque vous les recevez? Faites-vous comme certains et les classez-vous immédiatement dans vos dossiers ou si vous les analysez? On y retrouve pourtant une foule d’informations pertinentes pour votre troupeau.
L’agronome Jean-Philippe Laroche, expert en production laitière – nutrition et fourrages chez Lactanet, a expliqué ces précieuses analyses lors d’un webinaire le 19 avril 2023. Il a démontré, point par point, les aspects à regarder dans une analyse de fourrages.
Qualité optimale de la récolte
À lire aussi

Ils reviennent déçus de leur visite de fermes porcines danoises
Les producteurs de la Ferme Les Cochons du Roy de Saint-Michel-de-Bellechasse, sont revenus déçus de leurs visites de fermes porcines au Danemark.
La qualité optimale de la récolte s’évalue par trois aspects : la maturité des plantes, le niveau de matière sèche et la contamination par le sol. La fibre détergent acide (ADF) doit être autour de 30% pour les vaches bonnes productrices. « C’est l’indicateur par excellence pour la maturité de récolte, dit Jean-Philippe Laroche. Si on récolte notre fourrage au bon moment de maturité, tout le reste va suivre. » Il y aura alors davantage de sucres, de protéines et de gras. Parfois, les producteurs récoltent plus tard pour avoir plus de fibres dans la ration. Toutefois, en ayant un fourrage plus jeune, il est possible d’en mettre davantage dans la ration et la vache. Finalement, la vache en consommera autant dans sa ration qu’avec un fourrage récolté plus tard avec un coût des concentrés moindres.
Pour avoir une qualité optimale de récolte, Jean-Philippe Laroche prône la technique du « vite et lent ». En début de saison, le rendement est élevé et la qualité diminue rapidement. Alors, on récolte tôt. En fin de saison, le rendement est plus faible et la qualité pardonne davantage. Il est alors possible de laisser la plante épier ou fleurir pour aider la plante à se refaire des réserves sans trop affecter la qualité.
La matière sèche ne devrait jamais être inférieure à 30%. C’est pourtant le cas de 7% des analyses reçues au laboratoire de Lactanet. Le taux de matière sèche doit aussi être adapté au système d’entreposage. Un fourrage trop humide crée des écoulements de jus riches en nutriments et il s’agit d’un environnement idéal pour les mauvaises bactéries. S’il est trop sec, il y a une mauvaise compaction et une présence d’oxygène (risque de chauffage).

La contamination par le sol ne devrait pas être supérieure à 10%. C’est pourtant 18% des analyses de fourrages qui contiennent trop de cendres. Les cendres n’apportent pas d’énergie en plus d’être source de mauvaises bactéries. Un taux élevé de cendres diminue la performance des animaux et augmente le risque de mauvaise fermentation. Pour le réduire, il faut réduire la contamination par le sol en haussant la barre de coupe à 10 centimètres ou 4 pouces. De plus, des andains larges, le choix des équipements et l’ajustement des équipements aident à réduire les cendres.
Qualité de l’entreposage
La qualité de l’entreposage se mesure par trois aspects : la qualité de la fermentation, la stabilité de la fermentation et le chauffage. Sur l’analyse, la qualité de fermentation est identifiée, s’il y a lieu, par les données de profil de fermentation (« rapport acide lactique/acides totaux », « acide acétique » et « acide butyrique ») et par l’ammoniac (N-NH3). L’acide lactique/acides totaux doit être d’au moins 65% parce que c’est l’acide le plus efficace pour baisser le pH de l’ensilage. L’acide acétique doit être de moins de 3%. La présence d’acide butyrique n’est pas souhaitable, mais il est possible d’en tolérer jusqu’à 0,3%. Il y a 17% des échantillons qui dépassent ce seuil. L’ammoniac ne devrait pas représenter plus de 15% de la protéine brute. Si ce nombre est plus élevé, cela signifie que la protéine brute a été dégradée par les mauvaises bactéries. Cela peut avoir un impact négatif sur les coûts d’alimentation.
Une mauvaise fermentation coûte cher parce qu’il y a une perte de matière sèche et de nutriments. Cela diminue aussi la qualité des protéines, rend les fourrages moins appétants et apporte parfois des problèmes de santé chez les animaux. Trois causes peuvent être à la source d’une mauvaise fermentation : la contamination excessive par des mauvaises bactéries, un ensilage trop humide ou un pH élevé trop longtemps.
Un entreposage rapide après la fauche permettra de conserver les sucres. Il y a quatre règles de base pour bien réussir la récolte d’un ensilage riche en sucres : il faut du soleil, une hauteur de fauche à 10 centimètres (4 pouces), sans conditionner et avoir des andains de plus de 80% de la largeur de la barre de coupe. Des andains larges permettront de faire sécher le fourrage rapidement grâce à l’action du soleil. Le conditionneur nuit parce qu’il réduit la capacité de séchage de l’herbe en andains larges tout de suite après la fauche, alors que le foin sec bénéficie de l’action du conditionneur puisque le fourrage est plus sec.
L’utilisation d’inoculants homofermentaires permet de réduire de façon importante les pertes de matière sèche. Jean-Philippe Laroche le recommande à tous les clients qui font de l’ensilage d’herbes à moins de 50% de matières sèches. Cependant, il n’y a pas d’avantages avec l’ensilage de maïs, car c’est un ensilage qui fermente bien naturellement.
La stabilité de l’ensilage dépend du niveau de matière sèche. Pour sa part, le chauffage s’évalue par le PB-ADF qui doit être de moins de 10%. Ce sont 11% des échantillons qui ont chauffé. Le chauffage survient lorsque de l’oxygène est réintroduite dans l’ensilage, ce qui peut amener une perte de contrôle. Jean-Philippe Laroche recommande de vérifier si l’ensilage chauffe par : mauvaise compaction, ensilage exposé trop longtemps, étanchéité du silo non optimisé, face du silo non uniforme, taux de reprise insuffisant et transfert d’ensilage.
Carences en minéraux
Les minéraux permettent de valider la fertilisation. Bien que très rares dans les fourrages, les carences en soufre sont de plus en plus fréquentes dans la luzerne. Cela entraîne une baisse de rendement et une baisse de protéines brutes.
En résumé, le tableau suivant montre les analyses recommandées.

Il est possible de voir ou revoir le webinaire sur la page YouTube et Facebook de Lactanet en cliquant ici.