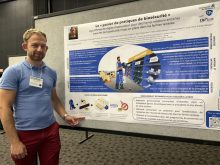L’intérêt et la prise de conscience pour la propagation des maladies et des virus n’a jamais été aussi importante de mémoire récente que dans les dernières années. Le moment est propice selon le MAPAQ pour ramener à l’avant-plan l’importance de la biosécurité à la ferme sous l’angle des cultures. Un changement des mentalités est souhaité sur cette question puisqu’elle met en jeu la rentabilité des entreprises agricoles.
Bien que des campagnes de sensibilisation soient en place depuis 2010, le ministère souhaite profiter de la situation liée à la pandémie et les récentes maladies infectieuses dans les élevages pour rappeler l’importance d’instaurer des mesures de biosécurité dans les champs, des méthodes qui ont fait leur preuve en santé animale, mais aussi dans certains pays, insiste Josée Tremblay, conseillère en biosécurité à la Direction de la phytoprotection du MAPAQ. » Des normes de biosécurité sous forme de règlements ont permis de réduire considérablement certaines pathologies dans la pomme de terre depuis 2010. Des pays comme la Grande-Bretagne et l’Australie ont aussi adopté des règlements phytosanitaires avec succès puisqu’ils ont permis de réduire la propagation des organismes nuisibles. »
Plusieurs fiches d’informations ont été rendues disponibles, d’autres encore le seront sur les manières d’appliquer les différents protocoles recommandés.
À lire aussi

Application de pesticides par drones: en attente d’un décollage en règle!
Santé Canada sollicite l’avis du public sur un projet de règlement qui permettrait l’application de pesticides par drone. Présentement, très peu de produits sont autorisés à être utilisés légalement par drone.
La biosécurité concerne toutes les mesures réduisant l’impact des maladies et des insectes nuisibles dans une approche agroenvironnementale. Josée Tremblay indique, par contre, que tous les déplacements liés aux activités humaines ont un rôle important à jouer, que ce soit par les interventions du producteur dans ses champs, les allées et venues des différents intervenants qui se déplacent d’une ferme à l’autre, ou encore les travaux à forfaits. Quelques gestes peuvent cependant faire une différence, note la conseillère. « Si j’avais une mesure phare à recommander, ce serait le nettoyage de tout ce qui vient de l’extérieur de la ferme. Ce genre de geste est sous-estimé, mais il peut avoir un grand impact en limitant la propagation des mauvaises herbes et des organismes nuisibles responsables de la baisse de rendements. On les propage alors qu’on met beaucoup d’argent dans les mesures de phytoprotection, au point qu’on considère ça normal. Pourtant, la prévention a fait ses preuves. »
L’introduction de l’amarante tuberculée résistante aux herbicides au Québec serait d’ailleurs liée à l’utilisation de machinerie achetée aux États-Unis. Les fournisseurs de travaux à forfaits doivent également s’assurer de ne pas contaminer les champs en passant d’un client à l’autre.
Sur une même ferme, le nettoyage peut prendre la forme d’un nettoyage rapide à l’air entre les champs. On peut aussi nettoyer par pression à l’eau à un endroit déterminé. Le site de nettoyage du pulvérisateur peut d’ailleurs être utilisé sous certaines conditions. Le principe de gestion du risque doit être appliqué selon la connaissance des pathologies dans le champ, explique la conseillère. On se déplace des champs les moins à risque à ceux comportant le plus de risques. « Plus les risques sont élevés, plus les normes à respecter sont élevées. » De même, on peut changer de bottes ou de vêtements, nettoyer à l’eau ou au désinfectant, selon les risques en place.
Une autre mesure simple à appliquer à la ferme pour Josée Tremblay est de déterminer une entrée et une sortie pour les véhicules, ce qui réduit les contaminations. Des zones de stationnement, et de routes dans les champs vont dans le même sens.
Certaines menaces sont à prendre plus au sérieux. C’est le cas des mauvaises herbes résistantes aux herbicides dont le nombre tend à croître au Québec. C’est aussi le cas du nématode à kyste du soya qui une fois implanté dans un champ est impossible à détruire. Josée Tremblay nomme aussi l’hernie du crucifère et le virus de la mosaïque du soya.
La biosécurité est également l’affaire de toutes les cultures, rappelle la conseillère, que ce soit dans les grandes cultures, le secteur maraîcher ou les petits fruits.
« La biosécurité devient un incontournable pour limiter les ennemis des cultures. Les mesures de biosécurité doivent faire partie des nouvelles pratiques de gestion. C’est du temps bien investi et c’est le bon temps pour en faire usage. »
À consulter également:
Trousse d’information sur la biosécurité dans le secteur des grains
Fiche Nettoyage rapide d’une batteuse entre les champs
Dépliants pour les entreprises à forfait
Dépliants pour les intervenants
Plusieurs autres outils sont disponibles dans les trousses de biosécurité bleuet et pommes de terre . Ces fiches sont également applicables dans d’autres cultures.