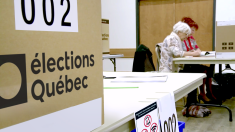Montréal (Québec), 21 juin 2006 – Invitée au troisième Forum urbain mondial (FUM3) qui se déroule à Vancouver jusqu’au 23 juin, Mme Helen Fotopulos, membre du comité exécutif, responsable de l’environnement, des parcs, des espaces verts et bleus et du mont-Royal et de la condition féminine, a souligné que face aux enjeux urbains tels que la dégradation du milieu naturel, la pauvreté, l’insécurité alimentaire, et l’exclusion sociale, il est nécessaire d’intégrer la stratégie de revitalisation intégrée au sein du plan d’urbanisme afin d’améliorer les conditions de vie des individus notamment par la préservation du milieu naturel.
« Il est de notre devoir de consolider et revitaliser les centres urbains afin d’améliorer la qualité du milieu de vie de nos citoyennes et citoyens dans une perspective de développement durable, où chacun trouve sa place. Nous devons relever plusieurs défis afin de modifier nos habitudes de consommation. Pour ce faire, il est nécessaire d’encourager la participation citoyenne et mobiliser les acteurs locaux, les partenaires privés et publics autour de ces enjeux », a déclaré Mme Fotopulos.
A cet effet, l’agriculture urbaine représente un phénomène prometteur qui démontre la capacité et la volonté des villes à transformer des terrains vacants à des fins productives et ainsi contribuer à la revitalisation des quartiers défavorisés. En ce sens, l’agriculture urbaine rejoint les Objectifs du Millénaire pour le développement de l’ONU, en particulier l’éradication de la pauvreté et de la faim; assurer un environnement durable, et la mise en place d’un partenariat global pour le développement.
« Il faut penser autrement et voir les villes comme des sociétés productives et non uniquement comme des sociétés de consommation », d’ajouter Mme Fotopulos.
Lors de la séance de réseautage Des partenariats avec les pauvres : des terrains pour le changement, Mme Fotopulos a indiqué que l’agriculture urbaine favorise l’inclusion sociale et le développement des quartiers urbains, encourage la participation des citoyens dans le processus de démocratie participative et a un impact positif sur la santé. Elle a par ailleurs fait valoir les avantages du programme municipal de jardins communautaires de la ville de Montréal, un modèle unique en son genre en Amérique du Nord, ainsi que le projet des « Paysages comestibles », géré par les facultés d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de l’Université McGill.
« Ces projets sont de parfaits exemples qui illustrent l’arrimage des préoccupations d’amélioration de la qualité des milieux de vie exprimées par les dirigeants municipaux, les ingénieurs, les architectes et urbanistes », de conclure Mme Fotopulos.
Montréal, une ville verte
La Ville de Montréal s’est donnée comme objectif de doter la métropole d’une véritable politique verte. Au cours des dernières années, l’administration municipale a adopté quelques grandes politiques et plans d’action en collaboration avec les arrondissements, les partenaires privés et publics. Mentionnons, la Politique de protection et de mise en valeur des milieux naturels visant à protéger 8% de son territoire dont 6 % en milieu terrestre. Sur les quelques 3000 hectares à protéger pour atteindre ce 6%, 1672 hectares le sont à ce jour, soit un peu plus de la moitié.
Mentionnons également la Politique de l’arbre et le Premier plan stratégique de développement durable de la collectivité montréalaise, des initiatives qui démontrent la volonté de l’administration municipale de préserver et de mettre en valeur le patrimoine naturel de la métropole.
D’autres moyens novateurs sont mis de l’avant pour assurer l’embellissement et le verdissement de la ville et répondre aux besoins en espaces verts des citoyens. Ces projets sont issus d’une concertation avec les citoyens, les partenaires privés et publics et les organismes communautaires.
Cultiver (dans) la Ville : les jardins communautaires
Les jardins communautaires font partie du paysage montréalais depuis de nombreuses années. Instauré en 1977, alors que l’administration municipale décrétait que 10% du territoire serait dorénavant zoné espaces verts, le programme de jardins communautaires permet aux citoyens de pratiquer le jardinage, un loisir, qui contribue au mieux-être de la collectivité. En plus de procurer un contact avec la nature et d’améliorer la qualité de vie, le jardinage communautaire stimule l’interaction sociale et permet la production d’aliments de qualité à faible coût.
Bien que les terrains appartiennent à la municipalité ou à des individus, les jardins sont gérés par un comité de jardin formé de citoyens bénévoles. A Montréal, près de 12 000 personnes, soit 1,5 % de la population, exploitent quelques 8000 jardinets des 97 jardins communautaires présents sur le territoire. Ce qui représente plus de la moitié des jardinets disponibles au Canada. C’est l’un des plus grands programmes du genre en Amérique du Nord.
L’engouement pour les jardins communautaires a par ailleurs favorisé l’émergence d’un réseau parallèle de jardins collectifs à Montréal. Les groupes de jardins collectifs se distinguent par le jardinage en commun plutôt que sur le jardinage individuel. 70% de la récolte est partagée entre les participants et 30% est offerte au réseau des banques alimentaires. En 2005, près de 30 groupes communautaires exploitaient des jardins collectifs.
Des toitures vertes pour enrayer les zones grises
Près de 80 % de la surface du territoire montréalais est bâtie ou pavée. La Ville de Montréal s’intéresse grandement au concept des toits végétalisés. D’ailleurs l’administration a mis sur pied un comité formé d’intervenants en habitation, en urbanisme aux infrastructures et en architecture afin d’étudier l’application d’une telle technologie à Montréal.
En plus de fournir un véritable oasis de verdure en plein cour de la ville, les toitures vertes contribuent notamment à la réduction du smog, à l’atténuation du bruit, à l’accroissement de l’efficacité énergétique du bâtiment, à la conservation de la biodiversité, tout en prolongeant la durée de vie des toits. La Ville soutient les initiatives du Centre d’écologie urbaine dans la publication et l’implantation d’un projet pilote de toit vert depuis ses débuts.
Projet de « paysages comestibles », Groupe habitation à coût modique (MCHG) de l’Université McGill
Le projet « Paysages comestibles » de l’Université McGill vise l’intégration permanente de l’agriculture urbaine dans les stratégies de revitalisation et de planification urbaine. Quatre villes participent au projet : Colombo (capitale du Sri Lanka, Asie); Kampala (capitale d’Ouganda, Afrique); Montréal; et Rosario (troisième ville d’Argentine en Amérique du Sud). Le projet est géré par le Groupe de l’habitation à coût modique (MCHG) de l’école d’architecture de l’université McGill. Chaque ville participante a des équipes multidisciplinaires regroupant des experts dans les domaines du design et du logement abordable, de l’urbanisme, l’horticulture et les sciences de l’environnement. Financé par l’ONU et le Centre de recherche et de développement international du Canada (CRDI), le projet bénéficie également du soutien de la Ville de Montréal qui agit à titre de partenaire.
Ce projet met à l’avant plan les réalisations de la Ville de Montréal dans le domaine de la revitalisation urbaine intégrée par l’intégration d’espaces verts et producteurs, et souligne ses efforts pour la préservation d’habitats naturels, le développement de quartiers dynamiques favorisant la mixité sociale et la sécurité alimentaire.
L’université McGill présentera les résultats de ses recherches lors d’un colloque sur les thèmes de l’agriculture et la revitalisation urbaine qui se déroule au pavillon Paysages comestibles « Edible Landscapes » du Forum urbain mondial. Les quatre villes partenaires, dont Montréal, présenteront une exposition où l’on retrouvera les projets suivants :
– Le programme municipal de jardins communautaires de la Ville de Montréal ;- La revitalisation urbaine et la réhabilitation de terrains contaminés ;- Une maison productive : la production en serre, les toits verts, les espaces communautaires.
À lire aussi

Météo: l’hiver bien installé au Québec
Environnement Canada a sorti ses prévisions météorologiques pour l’hiver. Que nous réserve Dame Nature pour les prochains mois?