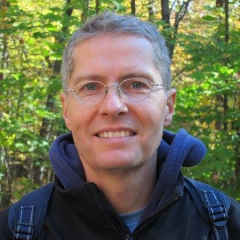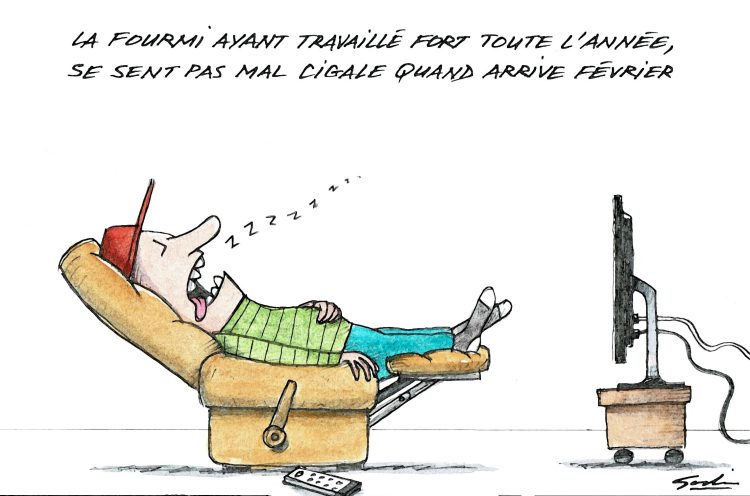Le 26 février dernier à Victoriaville, l’ingénieure Chloé Boucher-Ravenhorst du MAPAQ a donné une conférence intitulée « L’hydrologie régénérative, une approche pour faire face aux changements climatiques » dans le cadre du 11e colloque Bio pour tous !
L’hydrologie régénérative propose une façon de repenser le territoire agricole pour le rendre plus résilient face aux pluies intenses — des événements météorologiques qui seront de plus en plus récurrents.
À quoi peut-on s’attendre avec les changements climatiques d’ici 2050 ? Chloé Boucher-Ravenhorst cite le groupe Ouranos, qui se spécialise dans l’adaptation aux effets des changements climatiques : en hiver et au printemps, pour le climat continental humide, on s’attend en moyenne à avoir moins de précipitation sous forme de neige, plus de précipitations totales sous forme de pluies intenses, une augmentation du débit des cours d’eau et une augmentation des inondations.
À lire aussi

Les coupures en agriculture au fédéral sèment l’émoi
Après l’annonce de la fermeture de plusieurs centres de recherche au Canada, d’autres mises à pied ont été annoncées à l’Agence canadienne d’inspection des aliments. Plusieurs intervenants du secteur agricole ont réagi vivement à ces coupures.
En été et en automne, les précipitations totales seront les mêmes, mais on aura plus d’événements de pluies intenses ; une concentration des précipitations — donc des risques de périodes de sécheresse sur de plus longues périodes, entremêlées de risques de lessivage des sols au moment des pluies. À ces égards, « l’année 2023 a frappé l’imaginaire de plusieurs producteurs », a commenté Chloé Boucher-Ravenhorst.
« Historiquement, les activités humaines ont un effet perturbateur sur le cycle de l’eau », raconte Chloé Boucher-Ravenhorst. En milieu urbain, les espaces pavés et les canalisations dirigent l’eau de pluie rapidement vers les grands cours d’eau. En milieu agricole, les parcelles se sont agrandies au détriment de faussés, de digues, de haies. On a linéarisé des cours d’eau, des zones humides ont été drainées, et l’intensification des pratiques s’est faite au détriment des prairies.
« Les perturbations ont eu des effets bénéfiques sur l’agriculture, parce qu’elles ont permis d’augmenter les rendements, mais elles ont eu des impacts sur le cycle de l’eau et la capacité du paysage à répondre aux événements de pluie intense », constate Chloé Boucher-Ravenhorst
Qu’est-ce qu’on peut faire pour limiter les effets des pluies intenses dans les champs ?
L’hydrologie régénérative est un concept émergent et une approche multidisciplinaire provenant d’une rencontre qui a réuni en France ingénieurs, agronomes, consultants et producteurs pour réfléchir sur les questions de l’eau. En 2022, ils ont proposé une définition qui permettait de regarder différemment la gestion de l’eau : l’hydrologie régénérative est l’étude de la régénération des cycles d’eau douce par l’aménagement du territoire.
« Par régénération, on veut dire restaurer, améliorer, maintenir les cycles naturels de l’eau ; et quand on parle de territoire, ça peut se faire à différentes échelles, tant dans un grand bassin versant qu’à l’échelle parcellaire », précise Chloé Boucher-Ravenhorst.
La conférencière ajoute que « l’hydrologie régénérative n’invente pas de nouvelles pratiques ou de nouvelles techniques ; elle emprunte à des approches existantes, comme l’agriculture regénérative, la permaculture, l’agroécologie, l’agroforesterie, l’approche de gestion intégrée des eaux pluviales en milieu urbain, etc. »
Ça commence avec la santé des sols. Chloé Boucher-Ravenhorst décrit l’importance de la santé du sol de la façon suivante : « Un sol en santé est capable d’accumuler beaucoup plus d’eau qu’un sol qui est compacté. Il peut agir comme une éponge pour stocker l’eau — dans les pores, les vides et les “pailles” qui relient la surface avec la nappe phréatique. Les racines des plantes vont créer des micros et macropores qui peuvent emmagasiner l’eau. Un sol en santé va permettre aux racines de coloniser le sol dans son ensemble, en surface et en profondeur, créant des espaces pour l’eau. »
Dans la pratique, les producteurs peuvent aménager des bandes enherbées avec des plantes pérennes dans des endroits stratégiques du paysage pour ralentir le ruissellement, capter les particules en suspension, intercepter les sédiments, et du coup encourager la biodiversité. Aménagées en contour, dans des sections en pente forte, en bande riveraine ou ailleurs, ces bandes présentent une des mesures les moins couteuses à mettre en place.
Une stratégie empruntée à la permaculture propose d’aménager le champ en parallèle avec les courbes de niveau, permettant aux sillons de ralentir l’écoulement de l’eau. Une autre approche qui suit le principe du freinage de l’écoulement de l’eau : le producteur pourrait aménager en alternance des bandes de différentes cultures — idéalement une culture pérenne adjacente à une culture annuelle?; rectiligne ou à contrepente en suivant les courbes de niveau pour combiner les effets de ralentissement du ruissellement. De petits barrages naturels, murets ou autres peuvent bloquer et diriger l’eau, tandis que des noues végétalisées avec rives en pentes douces peuvent recueillir l’eau.
Plusieurs de ces différentes stratégies d’aménagement pour la gestion de l’eau peuvent se combiner entre elles, avec ou sans technique agricole de drainage plus conventionnelle. La totale, par exemple, verrait des bandes alternées le long de courbes de niveau séparées par des noues végétalisées, avec pour effet que chaque bande reçoive le moins possible l’eau de la bande voisine en amont.
L’hydrologie régénérative n’encourage pas des actions détrimentaires à la production agricole. «?Il faut que ça ait du sens pour l’entreprise agricole, pour son système agricole. Mais quand l’occasion se présente, quand on travaille le sol, c’est de penser que tout ce que l’on fait aura un impact sur comment l’eau va circuler. Il faut regarder la parcelle agricole différemment et se demander “si j’ai la chance de travailler sur la capacité d’infiltration de mon sol, est-ce que je peux le faire ?” », résume Chloé Boucher-Ravenhorst.
À lire aussi:
Québec annonce des changements à l’assurance récolte
Les changements climatiques selon Pascal Yiacouvakis
Les cultures ont été résilientes aux changements climatiques jusqu’à présent
Les couleurs automnales menacées par les changements climatiques
Les producteurs agricoles modifient leurs pratiques face aux changements climatiques