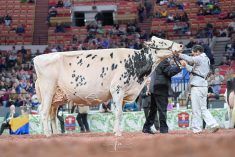Québec (Québec), 14 février 2003 – La Fédération des producteurs de porcs du Québec a déposé, dans le cadre des audiences du BAPE sur le développement durable de la production porcine, son rapport faisant état de l’avancement des pratiques agroenvironnementales des fermes porcines du Québec. « En plus de tracer le portrait de la situation sur nos fermes, cerapport témoigne de l’engagement des producteurs et productrices de porcs àaméliorer leurs pratiques agroenvironnementales. Il précise les progrèsaccomplis par les producteurs en cette matière tout en nous indiquant quelssont les défis qu’il nous reste à relever pour atteindre les objectifs quenous nous sommes fixés pour 2004. En somme, beaucoup a été fait, mais il enreste encore à faire », de déclarer le président de la Fédération, M. ClémentPouliot.
Le portrait actualisé mesure l’évolution des pratiques des producteurs deporcs relativement aux objectifs fixés pour 2004 dans le cadre des plansagroenvironnementaux régionaux lancés en 2000. Les résultats obtenus ont étérépartis en trois catégories, soit :
- Les objectifs atteints avant échéance
- Les objectifs qui seront atteints si l’évolution du paramètre se maintient au rythme des dernières années (1996 à 2001)
- Les objectifs qui, pour être atteints, nécessiteront des efforts supplémentaires
Parmi les résultats ayant déjà dépassé ou atteint leur objectif à laferme, on constate qu’en 2001 les superficies couvertes par un planagroenvironnemental de fertilisation ont atteint 95 %. L’objectif à atteindreen 2004 était de 85 %. Une autre donnée intéressante, la grande majorité ducheptel, 83 %, est nourri avec de la moulée contenant une enzyme (phytase) quidiminue les rejets en phosphore des élevages. L’objectif à atteindre était de72 %. Un chiffre aussi révélateur de l’amélioration des pratiquesagroenvironnementales en production porcine est la réduction de l’alimentationau sol des porcs, alors qu’on est passé de 33 % en 1996 à 10 % en 2001.L’objectif était de 21 %. En effet, cette méthode d’alimentation se traduitpar une perte d’efficacité alimentaire et donc, par une augmentation desrejets dans le lisier par rapport à une alimentation en trémie ou en auge. Unautre résultat relevé, 73 % du cheptel porcin est abreuvé avec des équipementsqui réduisent les apports d’eau dans le lisier, diminuant ainsi les volumes àépandre. Dans ce dernier cas, l’objectif fixé était de 68 %. Finalement, 100 %du cheptel sur fumier liquide est maintenant relié à une structure étanched’entreposage.
Comme résultante des diverses interventions entreprises par lesproducteurs, la charge réelle en phosphore provenant du lisier par rapport auxbesoins des cultures est passée de 264 % en 1996 à 185 % en 2001, alors quel’objectif était de 214 % pour 2004.
« Toutefois, a repris M. Clément Pouliot, des efforts importants doiventencore être consentis en ce qui a trait au contrôle des odeurs, plusparticulièrement en accélérant le recours aux rampes d’épandage, aux toituressur les structures d’entreposage et à la mise en place de haies brise-vent àproximité des sites de production animale ». Sur le premier aspect, rappelonsque, dès le 1er avril 2005, l’épandage par rampe du lisier de porc deviendraune obligation réglementaire. En ce qui a trait à l’installation de toituressur les structures d’entreposage, elle a légèrement augmenté depuis 1996,passant de 6 % à 7 % du cheptel porcin. Une telle progression ne peutpermettre cependant d’atteindre l’objectif visé de 12 %. Le résultat relatif àla proportion du cheptel porcin protégé par une haie brise-vent indique peu dechangement de la situation depuis 1996, soit 31 %. L’objectif visé pour 2004est de 47 %. « Sur une note plus positive, a ajouté M. Pouliot, on constate unetendance à l’augmentation de l’utilisation des structures d’entreposage decapacité supérieure à 250 jours, puisque nous sommes passés sur l’ensemble desfermes porcines du Québec de 63 % en 1996 à 68 % d’utilisation en 2001 ».
Le suivi des plans des interventions en production porcine a été effectuéen 2002 par les firmes BPR Groupe-conseil et Groupe Agéco Agroalimentaire etéconomie, sous forme d’enquête à l’échelle provinciale sur 588 fermesporcines. La marge d’erreur est de 5 %, 19 fois sur 20, pour chaque paramètremesuré.
« C’est la troisième fois depuis 1997, a conclu M. Clément Pouliot, queles producteurs et productrices de porcs réalisent un portrait de l’avancementde leurs pratiques. D’une part, ces portraits confirment que les producteurset productrices s’orientent vers une évolution agroenvironnementalesignificative. D’autre part, ils nous rappellent également que nous devonscontinuer de travailler sans relâche pour atteindre tous les objectifs dans lecadre de nos plans des interventions agroenvironnementales. »
Il est possible de se procurer une copie du rapport « Suivi des plans desinterventions agroenvironnementales des fermes porcines du Québec » en visitantle site de la Fédération des producteurs de porcs du Québec (section « Publications – Environnement »).
Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE)
http://www.bape.gouv.qc.ca/
Le Porc du Québec
http://www.leporcduquebec.qc.ca/
À lire aussi

Les nouveaux membres du Temple canadien de la renommée agricole
Le Temple canadien de la renommée agricole a dévoilé les nouveaux membres lors d’un gala en Colombie-Britannique. Une figure incontournable du secteur agricole au Québec a été intronisée.