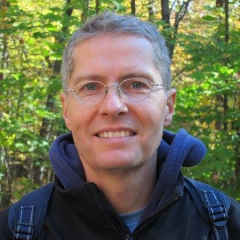Le Bulletin des agriculteurs a parlé au directeur général de l’Association des producteurs maraîchers du Québec, Pierre Léger Bourgoin, pour connaître sa perspective sur l’inflation alimentaire et les habitudes d’achat des consommateurs. En particulier, nous cherchions à savoir s’il percevait que les consommateurs, face à leurs contraintes budgétaires, tendaient à moins choisir les produits biologiques et retourner vers des options issues de l’agriculture conventionnelle. La conversation a bifurqué vers d’autres enjeux économiques importants auxquels les producteurs et les consommateurs sont confrontés.
Le Bulletin des agriculteurs : Avez-vous remarqué des changements dans la demande des consommateurs qui pourraient être liés à l’inflation alimentaire — par exemple, les consommateurs délaissent-ils les produits biologiques en raison de leurs prix généralement plus élevés?
Pierre Léger Bourgoin : Sans avoir vu les dernières données, chez les producteurs, que ce soit en circuit long ou en circuit court, j’ai reçu des commentaires sur le fait que les affaires sont beaucoup plus difficiles.
À lire aussi

Sollio améliore son bilan financier
Sollio affiche un bilan positif pour son dernier exercice financier. Olymel a généré un chiffre d’affaires en hausse, mais le secteur porcin continue à éprouver des difficultés.
Le gros enjeu, qui n’a pas nécessairement changé depuis deux ans, c’est la question liée à l’élasticité des prix. De manière générale, pour les produits frais, conventionnels et autres, on me rapporte que les volumes de vente sont moins élevés, parce que les consommateurs vont davantage privilégier les produits transformés que le produit frais en raison du coût élevé du panier d’épicerie. Et cet enjeu je le vois dans le conventionnel et le biologique.
Par contre, je vous dirais que les effets de l’inflation se sont fait sentir en premier dans le biologique.
Vous dites que les consommateurs se tournent vers les produits transformés. Pour les choix frais, plusieurs produits sont importés. Quels sont selon vous les enjeux de l’importation?
C’est clair que le produit d’importation, généralement parlant, à cause des coûts de transport, s’il n’est pas à prix égal va finir par coûter plus cher. Par contre, je vais vous donner un exemple très récent, qui date de janvier de cette année : j’ai une grande chaîne au Québec qui met en spécial un légume frais; il est capable d’aller chercher le produit en importation, alors il annule la commande du producteur qui avait le produit en inventaire pour aller chercher le produit en importation à meilleur marché. Mais le prix de vente n’a pas changé, avec une marge bénéficiaire qui a augmenté.
On regarde le mouvement de contestation en Europe qui s’étend — dans les nouvelles, récemment, on a vu que les producteurs agricoles de la Belgique viennent de se joindre au mouvement. Et quand on regarde les enjeux en Europe occidentale, ce sont les mêmes enjeux que l’on décrit ici : l’augmentation des coûts de production est énorme et les prix de vente à la ferme ont tendance à stagner. Cette position-là à long terme est insoutenable.
Quelles sont selon vous les solutions à moyen ou long terme? Le code de conduite pour les distributeurs et les détaillants? Des changements dans les pratiques, comme plus d’automatisation et de robotisation du côté des producteurs…?
Le code de conduite va clairement apporter certains bénéfices qui auront des effets plutôt sur le moyen et le long terme, si l’on se fie aux expériences ailleurs dans le monde. C’est clair que le bureau de la concurrence au Canada n’a pas les mêmes prérogatives que la Federal Trade Commission, son équivalent aux États-Unis. Dans le domaine de l’alimentation, on est d’avis que si le bureau de la concurrence avait une meilleure capacité pour faire des analyses, ce serait bénéfique pour l’industrie.
Maintenant, la robotisation et l’automatisation : ça va peut-être à long terme résoudre des enjeux liés à la pénurie de main-d’œuvre, mais dans la question de la réduction des coûts, ce n’est pas si limpide. Ces nouveaux équipements viennent avec un prix qui peut être assez élevé, et sur une ferme de taille moyenne, ça peut nécessiter beaucoup d’investissement.
Un élément qui est problématique, pour plusieurs raisons qui sont toutes valables, c’est que les attentes sociétales augmentent. La réglementation est de plus en plus contraignante, et cette réglementation a un coût au niveau de la production. C’est là que je pense qu’il devrait y avoir une réflexion, dans la mesure où il faut avoir les moyens de ses ambitions. Si la société veut que les lois soient de plus en plus contraignantes [en matière de santé et sécurité des travailleurs, protection de l’environnement, protection des consommateurs], il y a un prix à payer, et il faut que, collectivement, on soit prêt à payer ce prix-là.
Concrètement, le gouvernement canadien devrait appliquer de façon beaucoup plus proactive les règles de réciprocité des normes. Alors, si un produit doit être cultivé selon telles ou telles normes au Québec ou au Canada, techniquement, en vertu des dispositions du commerce mondial, le gouvernement canadien est en droit d’exiger que le produit qui arrive de l’extérieur respecte les mêmes normes. Ça, c’est une bataille qui, pour nous, devient de plus en plus importante. Tu ne peux pas être compétitif sur les marchés internationaux si les règles du jeu ne sont pas les mêmes — et je vais même aller plus loin : les entreprises cotées en bourse ont de plus à se soumettre à des règles de gouvernance interne liées au ESG [pour l’environnement, le social et la bonne gouvernance — des normes privées qui gèrent principalement des entreprises cotées en bourse].
On demande de plus en plus aux producteurs de faire la démonstration que leurs standards de règles de gouvernance en matière d’environnement, en matière sociale, respectent les critères les plus élevés. Étant donné qu’au Québec, les lois sont très restrictives sur la manière d’encadrer la santé et la sécurité au travail, et la protection de l’environnement, il faudrait que les critères auxquels on est soumis soient associés à une reconnaissance économique de cette application des critères. Si on nous demande d’appliquer ces critères au Québec, mais qu’on accepte l’importation d’un produit de l’extérieur parce qu’il est moins cher, c’est une contrainte supplémentaire pour le producteur local — alors que ça devrait être pour lui un avantage compétitif.
Mais pour en revenir à la question initiale du biologique, un secteur qui souffre plus que les autres, c’est le secteur des paniers, celui de l’agriculture de proximité. Je suis propriétaire du marché public de La Prairie, et les commerçants dans le biologique ont l’air, relativement parlant, de bien se porter. Mais à travers des conversations avec des membres de mon réseau, j’ai le sentiment que le milieu des paniers est plus difficile. À la Place des producteurs — l’ancien Marché Central — je suis témoin d’un phénomène depuis deux étés qui n’existait pas avant : des maraîchers en paniers bio débarquent le matin pour essayer de vendre leurs produits aux producteurs qui sont là parce qu’ils sont incapables d’écouler leur marchandise autrement.