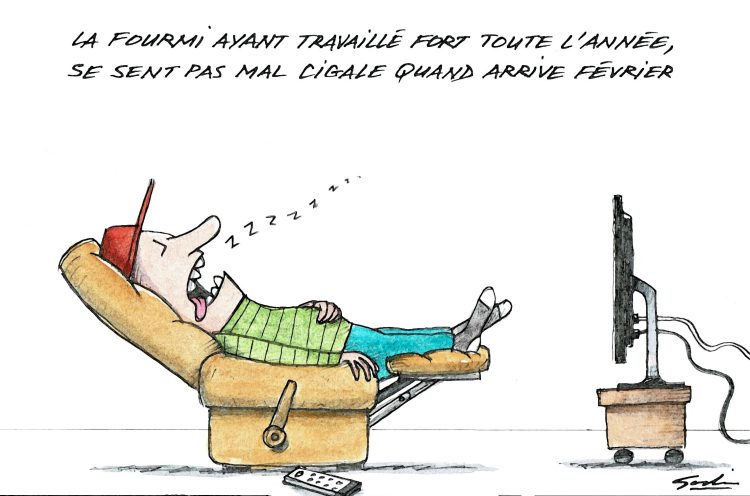Martin Chantigny est chercheur en biochimie des sols au Centre de recherche de Québec d’Agriculture et Agroalimentaire Canada depuis 1997. Il a dédié ses recherches à clarifier les cycles du carbone et de l’azote dans les sols agricoles et à comprendre comment l’azote et le carbone des fertilisants organiques et autres amendements contribuent à la santé des sols, à la formation de la matière organique et aux émissions de gaz à effet de serre.
Il a également contribué à préciser les mécanismes de formation de la matière organique dans les sols et notre compréhension du fonctionnement de la réserve d’azote du sol.
Le Bulletin des agriculteurs lui a posé une question que plusieurs producteurs se posent concernant l’accumulation de la matière organique dans le sol et l’utilisation de l’azote par la culture.
À lire aussi

2,1 millions nouvelles entailles toujours disponibles
Ce ne sont pas toutes les 7 millions de nouvelles entailles annoncées en juin 2025 qui ont trouvé preneur, ce qui est inhabituelle. Lors des précédentes émissions d’entailles, les demandes avaient été supérieures au nombre d’entailles offertes.
Le Bulletin des agriculteurs : « Si un producteur a énormément de résidus de maïs dans ses champs. Tellement que cela vient compliquer les semis. Est-ce que cela procure à ses sols toute la matière organique dont ils ont besoin? »
Martin Chantigny : « Oui et non. Dans les dernières années, il s’est fait beaucoup de recherche afin de déterminer la quantité de carbone présente dans les résidus végétaux qui va effectivement se stabiliser sous forme de matière organique dans le sol.
On s’est rendu compte que la partie aérienne des plants laisse finalement assez peu de matière organique dans le sol. Les données actuelles indiquent que la proportion varie entre 6 et 14%. Les pailles de céréale se rapprochent de 14%. Le maïs en laisse à peine 6 à 7%.
Par contre, les fumiers laissent une proportion de matière organique stable deux fois plus élevée, soit 12 à 24%. Dans le cas des cultures de couverture, je n’ai pas de chiffre précis pour le moment, mais j’ai l’impression que les parties aériennes vont se situer quelque part entre les résidus de culture et les fumiers.
Pour ce qui est des racines des cultures, on est dans une tout autre ligue. On sait maintenant que c’est la biomasse racinaire qui a vraiment un impact sur la teneur en matière organique : 45% du carbone des racines se stabiliserait dans le sol. Cela signifie que c’est en ayant le plus de racines possibles dans nos sols qu’on aura un impact important.
Ça veut dire avoir le plus de couverts végétaux possibles au cours de l’année et aussi choisir des espèces qui produisent beaucoup de racines. Le maïs, ce n’est pas l’espèce qui produit le plus de racines… Les graminées, comme le seigle ou le ray-grass, sont au contraire des plantes qui développent de forts réseaux racinaires.
De la même façon, les plantes pérennes développent beaucoup plus de racines que les plantes annuelles. Dans les cultures de couverture, je rechercherais un mélange qui comprend les trois familles de plantes : légumineuses, crucifères et graminées. »
Lisez l’article complet sur le sujet dans le magazine de juin du Bulletin des agriculteurs.