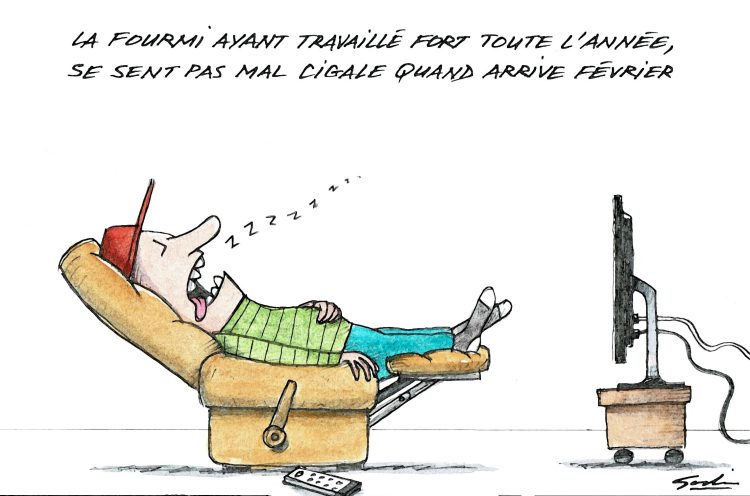Les vomitoxines sont produites par des champignons responsables de la pourriture de l’épi. L’agent pathogène Fusarium graminerum produit des spores et infecte les épis par les soies ou les blessures provoquées par les oiseaux et les insectes. Le développement de la maladie est favorisé par du temps frais et pluvieux peu de temps après l’apparition des soies, car ces conditions favorisent la production de spores. La maladie est reconnaissable par la moisissure rose à rougeâtre sur les grains à l’extrémité de l’épi. Il est important de bien identifier les champignons présents puisque certaines espèces, comme le Diplodia maydis, causent également la pourriture de l’épi, mais ne produisent pas de mycotoxines.
Le champignon pathogène se conserve dans le sol et les débris végétaux. Ce champignon n’infecte pas seulement le maïs, mais aussi les céréales à paille comme le blé. Après l’infection, les conditions météo sont déterminantes pour le développement des vomitoxines. Ainsi, une récolte tardive avec des précipitations plus fréquentes permet au champignon de poursuivre sa croissance et d’accumuler des toxines.
Est-ce que qu’une application de fongicides est utile? Kiersten Wise, phytopathologiste de l’Université Purdue, a publié en 2017 des résultats démontrant l’efficacité des fongicides pour réduire la pourriture des épis deux années sur trois, mais que ces derniers n’ont pas réussi à diminuer le DON. Les données avec les nouvelles molécules récemment homologuées ne sont pas encore disponibles pour faire une recommandation.
À lire aussi

Des céréales secouées par le dollar américain
Les turbulences économiques et politiques aux États-Unis ont fait grimper les céréales avec le blé comme gagnant de la semaine.
Que faire pour réduire les risques de contamination ?
Le choix d’un hybride offrant une résistance génétique est certainement la meilleure assurance contre les infections de pourritures de l’épi. Parfois, cette information peut être difficile à obtenir. Dans ce cas, une résistance à la pourriture de la tige causée par le même champignon peut être un bon indicateur de cette résistance génétique. De plus, les hybrides avec des spathes qui recouvrent bien les grains offrent une barrière physique contre les infections. Les différentes biotechnologies contre les insectes (Bt, SmartStax, Duracade, Trecepta, etc.) sont aussi utiles pour protéger les plantes. Moins de dommages par les insectes prévient les infections secondaires de champignons.
La gestion des résidus est aussi un point important dans la lutte contre la maladie. Puisque les champignons survivent à l’hiver sur les débris végétaux, la rotation avec une culture non sensible l’année suivante ou l’enfouissement des résidus est une bonne stratégie. Des travaux réalisés à l’Université Cornell dans l’État de New York a aussi démontré la présence d’inoculum dans l’air. Les vents peuvent transporter les spores et infecter les champs voisins qui ne présentaient pas de risques élevés de prime abord.
Lors de la récolte, les grains moisis doivent être séchés rapidement. Les champignons continuent de produire des toxines jusqu’à ce que l’humidité baisse sous les 20 %. À partir de ce moment, la croissance des champignons s’arrête, mais la teneur en toxines ne change pas. Afin d’éviter les problèmes, il est préférable de tester le grain avant son utilisation dans l’alimentation animale.
Source : PennState Extension, Maladies des grandes cultures au Canada