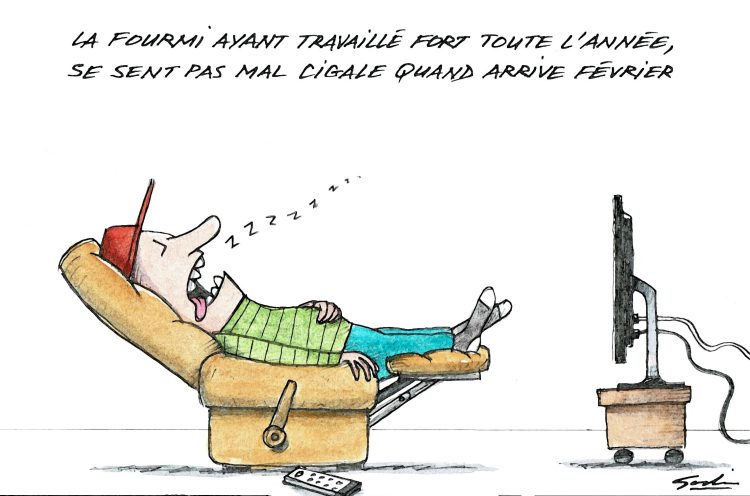Avec les plus importants semis jamais réalisés dans le blé d’automne au Québec l’automne dernier, quelle est la survie hivernale de la céréale? La question se pose d’autant plus cette année que l’automne exceptionnellement doux de 2021 a fait s’interroger plusieurs experts. La céréale allait-elle consacrer trop d’énergie à la production de feuilles et moins à l’emmagasinement d’énergie dans les racines ou bien profiterait-elle de ce prolongement inhabituel de la saison?
Un premier aperçu du Réseau d’avertissement phytosanitaire (RAP) à la fin avril estimait qu’il était encore trop tôt pour livrer un verdict, puisque le temps frais n’avait pas permis aux plantes de sortir complètement de leur dormance. La situation en Montérégie paraissait plus problématique en raison de la pluie et du gel qui s’étaient succédé cet hiver.
Quelques semaines et une canicule plus tard, le portrait global se dessine un peu plus. Selon Michel McElroy, chercheur au Centre de recherche sur les grains (CEROM) et spécialiste du blé d’automne, la situation semble bonne en général. Il se base sur les différentes conversations qu’il a eues avec des producteurs, ainsi que sur ses observations des parcelles de blé d’automne du CEROM qu’il peut contempler de son bureau. « La survie semble bonne en général, mais il semble que ce soit variable dans l’ensemble du champ avec des zones mortes, mais aussi d’un champ à l’autre où la survie est bonne dans un champ sur deux. » Il a observé la même chose dans ses parcelles où 95% des plants ont bien survécu, mais avec de petites zones de mortalité assez sévères.
À lire aussi

De nouveaux produits pour les érablières
Le secteur acéricole se développe à vitesse grand V. Voici un aperçu des nouveautés offertes par les fabricants et manufacturiers pour la prochaine saison des sucres.
Plusieurs raisons pourraient expliquer les zones endommagées. « Ce pourrait s’expliquer par l’accumulation d’eau dans le champ. La glace formée endommage plus le blé puisqu’elle n’a pas les mêmes propriétés isolantes que la neige. La glace est plus froide et peut empêcher le blé de respirer, ce qui peut causer la mort du plant par manque d’oxygène. Le blé n’est pas non plus du riz : il ne pousse pas dans l’eau. Le printemps peut donc avoir réuni des conditions plus stressantes avec de la pluie qui a succédé à la neige, avec parfois des parties du champ à nu. »
Michel McElroy avait lui-même tenté une expérience cet automne en passant la tondeuse sur des sections de parcelle devant le trop grand enthousiasme de son blé. Le constat de cette expérience maison? « J’avais mis des drapeaux pour distinguer les deux sections et heureusement que je l’ai fait, car il n’y a aucune différence », explique le chercheur. Ses deux sections ont bien survécu, indifféremment au fait que l’une d’elle ait été tondue ou pas. M. McElroy n’a pas non plus détecté de moisissure hivernale dans les plants plus garnis, malgré l’abondance du feuillage.
Quant aux soins à prodiguer au blé d’automne pour qu’il poursuive sur sa lancée, M. McElroy rappelle qu’il n’est ni agronome ni conseiller. Il indique toutefois que les applications azotées tôt dans la saison vont favoriser la production de grains, alors qu’à mesure qu’elles seront réalisées tard dans la saison, elle vont plutôt aider à la production de protéine dans les grains, une chose à retenir pour les producteurs de blé panifiable.
Puisque les recherches ne cessent jamais pour améliorer les connaissances, le CEROM mène en ce moment une enquête sur la survie des céréales d’automne. Les producteurs sont invités à répondre à un bref sondage.