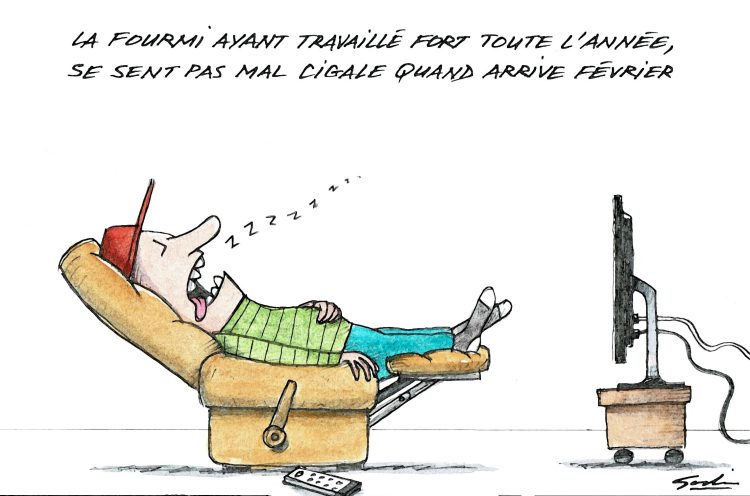« La préoccupation numéro de la relève est l’accessibilité aux terres », affirme Krishen Rangasamy, directeur aux services économiques et économiste principal à Financement agricole Canada. L’expert sait de quoi il parle puisqu’il rencontre de jeunes agriculteurs depuis deux ans et la question qui revenait sans cesse était celle de l’accès, dit-il.
Valeur des terres
La relève a de quoi s’inquiéter, fait remarquer Krishen Rangasamy. La valeur des terres a monté en flèche dans les dernières années, parfois plus de 10 % sur un an, pendant plusieurs années de suite. Le résultat est le pire indice d’abordabilité des terres depuis 2005. L’équipe de FAC s’est inspirée des calculs de la Banque du Canada (BdC), qui fait ce type d’indice dans l’immobilier, pour créer le même pour l’accès aux terres agricoles. Si l’indice de la BdC démontre que le marché immobilier a triplé sa valeur en 40 ans, ce n’est rien à côté de celui des terres agricoles qui s’est multiplié par six pendant la même période.
À lire aussi

Agenda des événements agricoles
Colloque sur les plantes fourragères, Sommet sur l’eau, Journée ovine, Webinaires sur l’agrométéorologie, il y en a pour tous les goûts cette semaine. Tous les détails dans votre agenda des évènements agricoles.
FAC n’a pas d’indice distinct pour chacune des provinces, mais une disparité est évidente, avec des situations pires dans certaines d’entre elles. « En Ontario, il est clair que l’abordabilité décline depuis plusieurs années », illustre l’économiste.
De plus, la rentabilité des terres devrait stagner pour une troisième année consécutive en 2025. FAC prévoit une baisse du prix des céréales et des oléagineux, ainsi qu’une hausse du coût des intrants La concurrence dans la location des terres fait également grimper les coûts. Pour ceux louant actuellement des terres, 2025 pourrait être la troisième année consécutive marquée par des marges négatives, si l’on tient compte de tous les coûts variables et fixes, indique FAC. « Actuellement, ce n’est pas un bon moment pour un jeune d’entrer dans la business », dit le spécialiste.
Entente de métayage
Après une rencontre avec la relève agricole l’an dernier, Krishen Rangasamy s’est demandé comment il pourrait répondre concrètement aux jeunes qui cherchent un meilleur accès aux terres. Après avoir discuté avec les agroéconomistes de FAC, il en est venu à explorer le métayage, une pratique méconnue dans l’Est du pays, mais pratiquée par 5 à 10 % des producteurs agricoles dans l’Ouest. L’équipe a préparé un document présentant la pratique, ce qui a suscité beaucoup de questions lors de la présentation de la FAC auprès de la relève au Québec. « Le métayage est un moyen pour passer la barrière que représente le prix élevé des terres, que ce soit par achat ou location », explique-t-il.
Tel que dit dans le document de la FAC, une entente de métayage repose sur un partage des récoltes entre le propriétaire foncier et le producteur selon un rapport d’un tiers/deux tiers ou d’un quart/trois quarts. On parle de deux tiers ou de trois quarts de la part de la récolte du point de vue du producteur. Le propriétaire fournit la terre et une partie (soit le tiers ou le quart) des intrants de culture (par exemple, les semences, l’engrais, les produits chimiques et l’assurance-récolte), tandis que le producteur fournit toute la machinerie, la main-d’œuvre et le reste des intrants.
Selon les calculs de la FAC, le métayage permet d’augmenter les revenus. Il peut arriver que certaines années soient moins profitables que d’autres, mais à tout le moins, le métayage représente un moyen de diminuer le risque qui est très important actuellement pour la relève agricole, fait valoir l’économiste.
Avantages du métayage
Pourquoi un agriculteur renoncerait-il à l’argent provenant d’une location tout en s’exposant aux risques? Les avantages sont nombreux, souligne l’expert.
Les propriétaires peuvent vouloir établir des relations solides et à long terme avec les producteurs agricoles, afin de garantir une réussite commune dans le temps, puisqu’ils auraient tout intérêt à ce que leurs locataires réussissent à long terme. Cela procurerait aux propriétaires fonciers plus d’influence sur les décisions de gestion des terres afin de garantir la pérennité de la terre, tout en profitant des bonnes années, et en diminuant le risque dans les moins bonnes.
Des agriculteurs qui prennent leur retraite pourraient conserver leur statut de producteur agricole à des fins fiscales avec le métayage, tout en restant actif. Au fil du temps, les baux de métayage pourraient être structurés de manière à ce que la moyenne soit égale au rendement des contrats de location au comptant. Il s’agit également d’une solution de rechange pour le cas de transfert en relève non-apparentée.
Krishen Rangasamy souligne qu’il n’y a pas de contrat standard. Les exemples les plus fréquents sont d’un partage d’un tiers à un quart des dépenses et des profits, mais tout peut être négocié à l’intérieur de l’entente, que ce soit la personne qui achète les intrants à celui qui fournit la machinerie. Il est aussi possible de sortir de ce cadre pour en adopter un autre. L’important est de consulter des experts avant de s’engager dans cette avenue et de faire rédiger un contrat en bonne et due forme, avec des professionnels.
Avec les prochaines années qui risquent d’être plus difficiles, le métayage mérite qu’on s’y attarde. « La valeur des terres va continuer à augmenter, on ne produit pas plus de terre. Ça va demeurer l’enjeu numéro un », prévoit Krishen Rangasamy.
À lire aussi:
Accélération de l’augmentation de la valeur des terres agricoles