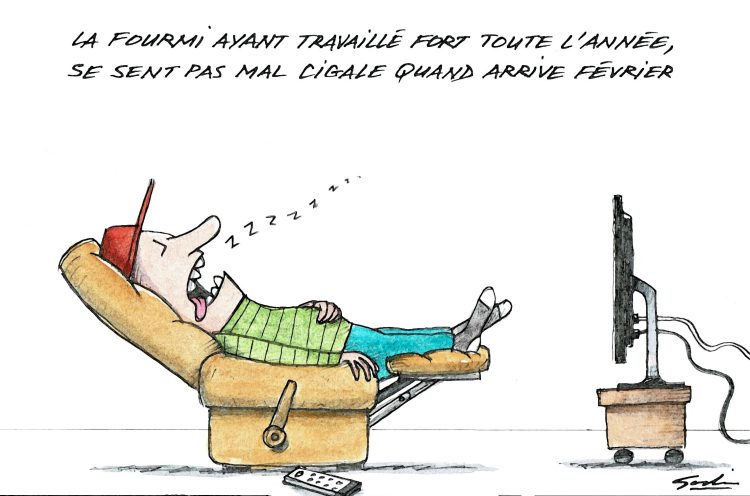Une belle brochette de chercheurs, d’agronomes, d’agriculteurs et de citoyens étaient réunis du 28 au 31 mars dernier au marché Bonsecours de Montréal dans le cadre de la 2e édition du Symposium sols vivants. On a voulu rassembler ces gens de secteurs différents pour discuter comment on peut régénérer la santé des sols.
La candidate au doctorat en conservation des sols Marie-Élise Samson a expliqué à quel point le sol, une ressource non renouvelable, était au coeur des enjeux planétaires de la souveraineté alimentaire et des changements climatiques. “Le défrichage des terres relâche du carbone dans l’atmosphère, ce qui contribue aux changements climatiques. Par contre, plusieurs pratiques agricoles permettent de stocker ce carbone dans le sol”, a-t-elle rappelé.
À lire aussi

Des céréales secouées par le dollar américain
Les turbulences économiques et politiques aux États-Unis ont fait grimper les céréales avec le blé comme gagnant de la semaine.
Une des meilleures façons d’y arriver est d’augmenter la biomasse en surface en implantant des cultures intercalaires, des cultures de couverture et des engrais verts. Faire des rotations avec des pâturages et des prairies est une autre avenue. Maximiser la productivité des terres agricoles déjà existantes, puis surtout minimiser les pertes par érosion ou lessivage aussi.
Présents à l’évènement, les agronomes Louis Robert et Odette Ménard, de même que le producteur de grandes cultures Jocelyn Michon ont fait l’apologie de la santé du sol et du semis direct. “Ça fait 30 ans que je prêche pour le semis direct et l’adoption est très lente, a mentionné Odette Ménard. Il y a beaucoup de résistance et d’émotivité. On n’allie pas nouvelles pratiques à rendement et rentabilité”, a-t-elle indiqué.
L’agronome Louis Robert, quant à lui, a remarqué dans sa pratique qu’une majorité de producteurs agricoles n’accordent pas beaucoup de crédibilité aux résultats de recherches scientifiques, ce qui est problématique selon lui. “Par exemple, l’application d’azote en fin de culture, ça ne donne rien, la recherche est unanime là-dessus et il y a encore des producteurs qui en mettent”, a-t-il illustré mentionnant au passage qu’il y a un écart grandissant entre les producteurs les plus performants et la moyenne. “Ce qui fait la différence, ce sont les compétences des producteurs, l’intérêt à en apprendre toujours davantage.”
Le producteur Jocelyn Michon de La Présentation fait une trentaine de conférences chaque année où il parle de semis direct et de sols vivants. D’ailleurs, les siens contiennent cinq tonnes à l’hectare de micro-organismes et plus de 400 vers de terre au mètre carré. Il a déploré le peu d’empressement au Québec pour adopter cette pratique. “C’est la transition qui est difficile. Ce sont les 3e et 4e années qui sont charnières pour savoir si un producteur va continuer ou non.” Des incitatifs à la transition devraient être instaurés, selon lui. “Ça prend des programmes d’aide à la transition plus généreux.” La Suisse et l’Australie ont des programmes intéressants pour inciter les producteurs à aller dans cette voie.
Lors d’un panel réunissant des maraîchers biologiques, on a abondé dans le même sens. “Regénérer les sols devrait être un projet de société, a indiqué François Daoust des Bontés de la Vallée, une ferme de légumes biologiques d’Havelock, en Montérégie. Ça ne devrait pas seulement être le producteur qui met son temps, son énergie et son argent. Il faut qu’on se rassemble vers cet objectif.”