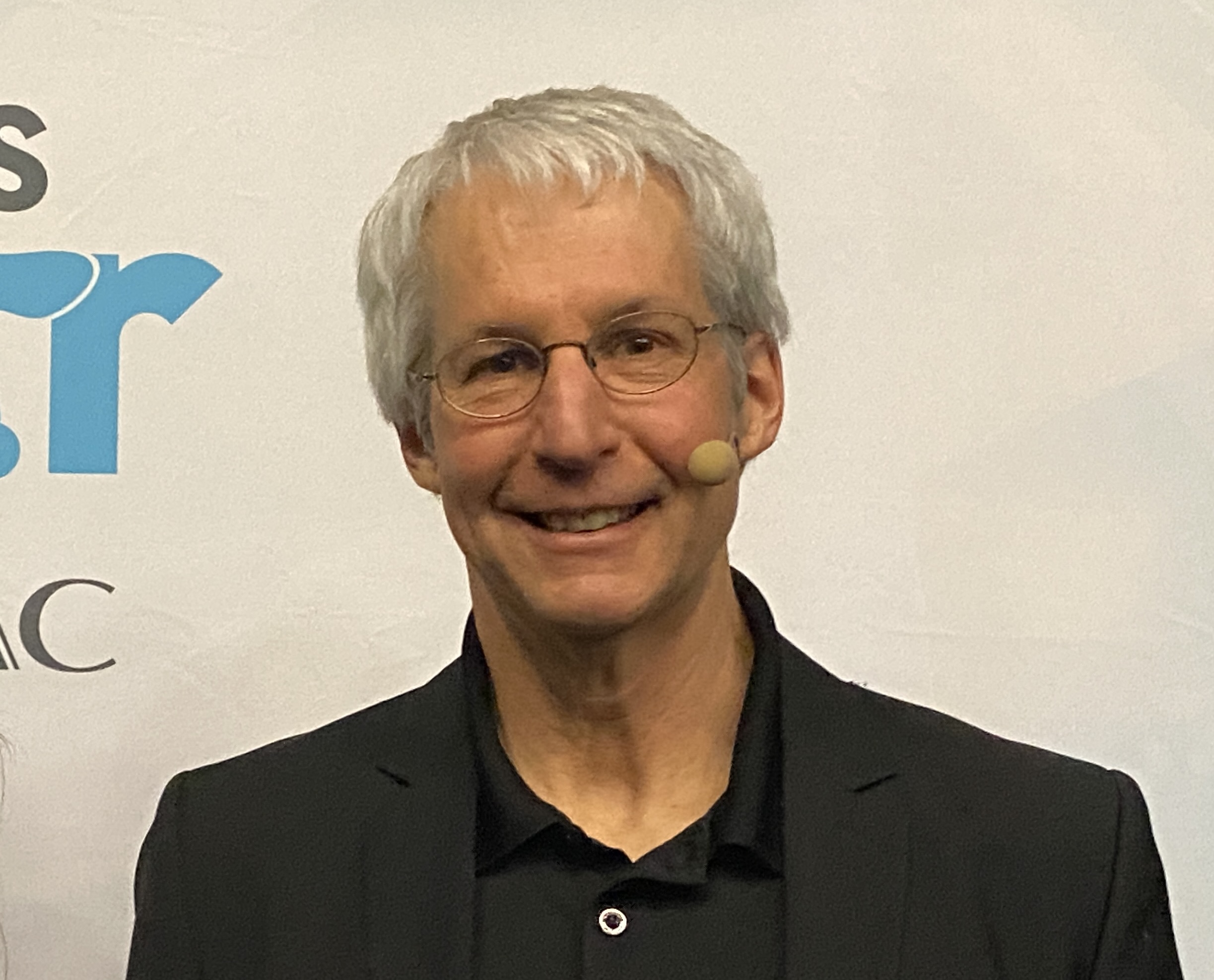Une petite révolution s’amorce avec les réductions des GES agricoles dans les prochaines décennies. «Les modifications qu’il y a eu dans la ferme laitière depuis 1950, c’est aussi important que les modifications à venir d’ici 2050», explique l’agronome Jacques Nault, vice-président agronomie chez Logiag. En 2019, il a réuni son équipe spécialisée en agroenvironnement pour leur dire : «On va accompagner les producteurs à faire la transition de réduction de gaz à effets de serre (GES)», a-t-il raconté lors d’une conférence donnée au Rendez-vous laitier, le 22 mars 2023 à Drummondville.
Selon Jacques Nault, l’industrie agricole est actuellement dans la mire de plusieurs industries puisque c’est la seule, par son activité, à avoir le potentiel de réduire son empreinte environnementale. Dans les dernières décennies, les sols en culture ont retiré du carbone du sol à la suite de la déforestation et aux méthodes de cultures passées. Alors que dans les années 1950, la matière organique du sol avoisinait les 6 ou 7%, elle est aujourd’hui de 2 à 3%. «Ce qui est intéressant, c’est qu’on peut le remettre», dit Jacques Nault.
Ainsi, en offrant un service d’accompagnement aux producteurs, Logiag veut tabler sur la capacité du sol à stocker le carbone. « Les sols constituent le 2e plus grand réservoir de carbone de la planète », dit Jacques Nault en parlant de la capacité du sol à stocker le carbone dans la matière organique qu’il contient. L’augmentation de la matière organique dans le sol apporte plusieurs bienfaits : amélioration de la fertilité du sol, rétention d’eau, résistance à l’érosion et biodiversité.
À lire aussi

Les producteurs de lait sont incités à produire plus de protéines
Le nouveau mode de paiement du lait récompense les producteurs qui livrent davantage de protéines dans leur lait et cette bonification sera encore plus grande à partir du 1er avril 2026. Les producteurs devront travailler de concert avec leurs conseillers pour y parvenir.
Mais attention! Ce projet ne vise pas la mise en marché de crédits carbone sur n’importe quel marché, mais il vise plutôt les marchés «insets», c’est-à-dire que ce sont les entreprises du secteur laitier qui en bénéficieront, contrairement aux marchés «offsets», comme les grands émetteurs tels les pétrolières. Comme l’explique Jacques Nault, les entreprises qui transforment les produits laitiers n’ont pas le potentiel de réduire leurs émissions de GES comme le font les producteurs laitiers, mais ils utilisent les produits laitiers. En fait, la réduction de GES calculés sera en kg de CO2 par litre de lait produit, par tonne de grain produit ou par kg de viande produite. C’est comme si cette réduction est rattachée à la production et que ceux qui l’utilisent en bénéficient aussi. La plateforme utilisée pour cela est celle de l’Ecosystem Services Market Consortium (ESMC), un organisme sans but lucratif.
Logiag collabore actuellement dans un projet pilote sur des fermes laitières initié par General Mills, qui détient la marque Liberté, et dans lequel Regénération Canada collabore également. Ce projet vise à accompagner les producteurs laitiers en faisant une analyse du cycle de vie par entreprise. L’inventaire des GES à la ferme est réalisé, notamment par des analyses de sol pour évaluer la présence de carbone dans le sol. Puis, de nouvelles pratiques seront mises en place, dont l’impact sur les émissions de GES et le carbone dans le sol et la qualité environnementale sera mesuré. Les processus prévoient la reconnaissance des résultats pour permettre un échange sur le marché «insets».
Plusieurs activités sur les fermes laitières offrent des potentiels de réduction de GES. C’est le cas notamment de la fermentation entérique avec l’amélioration du bien-être animal et des améliorations au niveau de l’alimentation. Une meilleure gestion des lisiers à la fosse et à l’application offre aussi un potentiel intéressant. Au niveau des champs, la gestion de l’azote et le travail réduit du sol offrent une opportunité de réduction de GES.
Pour Jacques Nault, les producteurs laitiers sont au cœur de la lutte à la réduction des GES. « Vous êtes la cavalerie de la lutte aux changements climatiques », explique l’agronome.