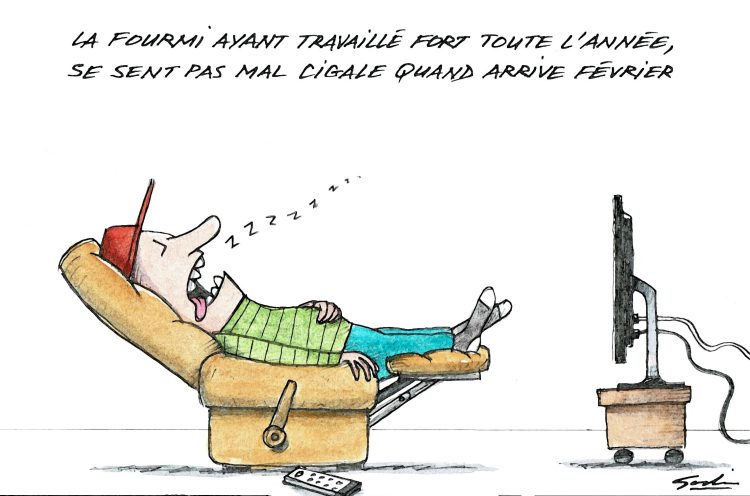La saison des sucres tire à sa fin au Québec. Pour certains producteurs, cela coïncide également malheureusement avec le sirop de bourgeon. Le phénomène apparait parfois en fin de saison. Il est lié à la montée de la sève dans les érables quand le temps devient plus chaud. Une odeur de souffre et un goût franchement désagréable vient gâcher le sirop produit qui perd alors beaucoup de sa valeur.
Le site Érable & Chalumeaux, créé par les biologistes Edith Bonneau et Stéphane Guay passionnés d’acériculture, a réalisé une capsule sur un nouveau traitement très prometteur permettant d’améliorer le goût du sirop de bourgeon. Une fois la conception optimisé, le procédé pourrait faire économiser des millions de dollars aux acériculteurs.
Comme l’explique Jean-Michel Lavoie, qui supervise les travaux de recherche sur le sujet, le sirop de bourgeon provient d’une interaction entre les micro-organismes et le sucre qui devient un acide aminé appelé diméthyldisulfure (DMDS). Dans le cadre de la Chaire de recherche industrielle sur les technologies acéricoles (CRITA), deux technologies ont été développées au Laboratoire des technologies de biomasse, afin de retirer le DMDS, la molécule responsable du goût et de l’odeur distinctive du sirop de bourgeon. Une autre technologie est également à l’étude sur le même sujet.
À lire aussi

De nouveaux produits pour les érablières
Le secteur acéricole se développe à vitesse grand V. Voici un aperçu des nouveautés offertes par les fabricants et manufacturiers pour la prochaine saison des sucres.
Les recherches n’ont pas été de tout repos. « C’est comme enlever une aiguille dans une botte de foin », explique Jean-Michel Lavoie, « puisqu’on parle ici de particules par milliards dans le cas du DMDS qu’on trouve dans le sirop d’érable ».
Le défi était donc d’isoler la molécule et de ne pas prélever dans le processus d’autres molécules qui auraient pu dénaturer le sirop d’érable.
Pour y arriver, les étudiants travaillant au laboratoire, situé à Sherbrooke, ont adapté des techniques déjà utilisées en génie chimique, dont certaines provenant du milieu pétrochimique, afin de cibler la molécule et la retirer. Il fallait trouver des techniques accessibles aux producteurs et qui ne nécessiteraient pas de technologies trop poussées, comme un accélérateur de particules, lance le chercheur.
L’autre difficulté qui s’est dressée durant les travaux a été de développer un test qui déterminerait et confirmerait avec exactitude et de manière répétée le retrait du DMDS du sirop. « Il fallait être très, très pointilleux dans les détails. » Les équipes ont eu recours à des équipements de pointe pour y arriver, tels que des systèmes de chromatographie et de spectroscopie.
Les recherches ont permis de mettre au point deux techniques différentes, une qui pourrait avoir lieu avant la mise au baril du sirop et l’autre, une fois en baril. La première serait donc accessible aux producteurs tandis que la deuxième, qui nécessite un équipement plus important, serait destinée aux associations qui pourraient traiter le sirop dans leurs entrepôts.
Il reste à optimiser les procédés pour les rendre le plus efficace possible, mais Jean-Michel Lavoie est très confiant qu’ils pourraient être bientôt mis à la disposition du milieu acéricole. Il dépendra ensuite de la volonté de ceux ayant accordé le mandat aux chercheurs d’y donner suite, puisque ce sont eux qui détiennent la propriété intellectuelle.
Les solutions trouvées par le laboratoire viendraient résoudre un problème auquel est confronté le milieu acéricole depuis des décennies. Les économies réalisées seraient appréciables, surtout, rappelle Jean-Michel Lavoie, qu’il en coûte le même prix pour réaliser un baril de sirop, que ce soit du sirop de bourgeon on non.
Dans les prochains mois, le Laboratoire fondé par Jean-Michel Lavoie aura un nouveau mandat du Comité de Développement de St-Romain du groupe Aménagement Forestier Coopératif des Appalaches. Il s’agira de développer une cabane à sucre 4.0, soit une installation dotée « du plus grand niveau d’automatisation jamais vu », grâce à l’intelligence artificielle, en traitant toutes sortes de données comme le ph et le débit. « On pourra prédire à l’avance des problématiques, par exemple par rapport aux saveurs, et travailler en amont pour avoir un meilleur suivi et une meilleure traçabilité. »
À lire aussi:
Les acériculteurs satisfaits de la saison des sucres