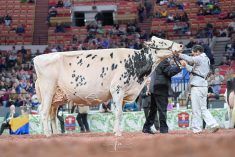Québec (Québec), 28 décembre 2001 – Lorsqu’en avril dernier, le gouvernement a lancé la Financière agricole – une sorte de fonds de solidarité ou de guichet unique – pour gérer l’ensemble des ressources mises à la disposition des agriculteurs, il a répondu à une requête exprimée depuis plus de 20 ans par les producteurs québécois.
Après l’adoption des modifications à la loi 184 concrétisant le droit de produire des agriculteurs, la mise sur pied de la Financière a fait dire au président de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Laurent Pellerin, que les agriculteurs devenaient enfin partenaires à part entière « dans la maîtrise des grands outils financiers qui les concernent ».
À lire aussi

L’UPA demande plus de transparence pour le projet de TGV
Des agriculteurs et des citoyens affectés par le tracé préliminaire du projet de TGV reliant Québec et Toronto ont manifesté le 24 février à Mirabel. Ils réclament plus de transparence dans ce dossier.
Cette bonne nouvelle a sûrement contribué à atténuer les effets des attaques et des nombreux reproches dirigés contre les façons de faire des agriculteurs par les environnementalistes, scientifiques et citadins.
En octobre, les agriculteurs ont encaissé durement le film « Bacon », un documentaire du cinéaste Hugo Latulippe sur l’industrie du porc. En fait, ils ne l’ont pas pris.
Une productrice de porcs, Suzanne Duquette, a vivement réagi au film, dans une lettre ouverte à La Presse et reprise dans La Terre de chez-nous, l’hebdomadaire du monde agricole.
« Je commence à être tannée de me faire dire par des écolos, professeurs de banlieue, cinéastes et agronomes, coincés dans un bureau, que je suis une pollueuse, a-t-elle écrit. Le pire, c’est quand on ajoute que je suis cruelle envers les animaux. La vérité est que je ne suis pas ‘une baronne du cochon’, propriétaire d’une mégaporcherie. Je suis une productrice de porcs qui travaille à la ferme familiale et ça finit là. »
Pendant toute l’année, les producteurs agricoles ont été victimes de séries télévisées sur ce qu’on a baptisé la « malbouffe », et ont entendu des scientifiques et spécialistes mettre en doute la qualité des aliments produits au Québec.
Appuyés par le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), les dirigeants de l’industie agricole n’ont pas baissé les bras et se sont volontairement lancés dans des campagnes de sensibilisation et de communication pour défendre leurs produits et leurs gestes, pour tenter de démontrer qu’ils ont été les premiers à prendre conscience des problèmes environnementaux qu’on leur attribuait.
Au rendez-vous des décideurs du secteur agro-alimentaire, tenu en octobre à Saint-Hyacinthe, M. Pellerin de l’UPA a lui-même fait état du défi qui attend les agriculteurs québécois. Il a rappelé que si, depuis 1998, les gouvernements ont investi près de 356 millions $ dans les différents programmes en agroenvironnement, les producteurs ont fait plus en engageant quelque 416 millions $ dans le même secteur durant la même période.
Pour bien démontrer le sérieux des agriculteurs au chapitre de l’environnement, l’UPA a d’ailleurs profité de son congrès annuel de décembre pour annoncer l’implantation d’un premier programme de certification environnementale sur les fermes.
Ce programme volontaire permettra d’instaurer et d’expérimenter dans 76 fermes réparties dans quatre régions du Québec un système de gestion environnementale respectant les critères de la norme internationale ISO 14001, reconnue dans plus de 110 pays.
En 2001, le monde agricole a aussi été témoin de la naissance de l’Union paysanne, un mouvement de contestation, regroupement de citoyens, producteurs, environnementalistes et propagandistes d’une agriculture plus traditionnelle, qui veulent parler au nom des plus petits et qui affirment ne pas trouver leur place dans « la grosse machine trop forte » qu’est devenue l’UPA.
Après s’être fait tirer l’oreille au cours des dernières années, le gouvernement de Bernard Landry a, le 6 décembre, rendu publique « La politique nationale de la ruralité », qui comporte inévitablement un important volet agricole visant, entre autres, à mettre en valeur le potentiel des produits alimentaires de niche et du terroir, réalisant ainsi un engagement pris en octobre lors du Rendez-vous de mi-parcours des décideurs de l’agriculture et de l’agroalimentaire.
Cette initiative a tout de suite été appuyée par la Financière agricole, qui s’est empressée de créer une nouvelle filiale, munie d’une enveloppe de 24 millions $, pour lancer des projets d’investissement en amont et en aval de l’agriculture ainsi que des initiatives de développement régional.
Le secteur agroalimentaire québécois, en 2001, c’est 376 450 emplois, un chiffre d’affaires de près de 14 milliards $ dans le seul secteur de la transformation. Au Québec, on compte aujourd’hui 44 132 producteurs agricoles oeuvrant dans 32 483 entreprises qui fournissent des emplois à 62 550 personnes et qui vendent des produits pour une valeur de 6 milliards $.
Les investissements dans le secteur de l’agriculture et de l’agroalimentaire ont dépassé, en 2001, les 1,5 milliard $.
Source : Presse Canadienne
Site(s) extérieur(s) cité(s) dans cet article :
La Financière agricole du Québec
http://www.financiereagricole.qc.ca
Ministère de l’agriculture des pêcheries et de l’alimentation du Québec (MAPAQ)
http://www.agr.gouv.qc.ca/
Union des producteurs agricoles (UPA)
http://www.upa.qc.ca/